Créé le: 05.11.2018
1645
0
0
Isidro chapitre 10/ En Syrie
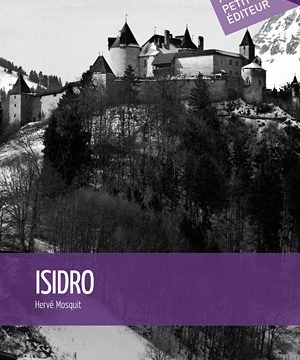
Isidro voyage et prend des risques….
Reprendre la lecture
Isidro chapitre 10
Les vacances de Pâques approchaient. Je venais de terminer mon travail de maturité, ce fameux TM qui plombe la disponibilité et la bonne humeur des lycéens en leur imposant, l’année précédant le baccalauréat, une recherche approfondie, sur un sujet et dans la banche de leur choix, le tout en respectant évidemment une procédure précise et des directives qui ne le sont pas moins, tant sur la forme que sur le fond.
J’étais donc, par bonheur, assez disponible. L’expression par bonheur m’apparaît aujourd’hui relativement outrancière et malvenue, compte tenu de la série de bêtises et d’imprudences crasses que nous nous apprêtions à commettre, Marwan et moi.
Pour avoir les coudées franches, j’avais fortement encouragé Mamounette et Paolo à partir en croisière autour de l’Italie et jusqu’aux Baléares. J’avais dit que je préférais passer du temps avec des amis. La seule et unique croisière que j’avais faite avec eux nous avait emmenés de Savonna en Italie, à Barcelone, puis à Palma de Majorque et Marseille. Un aspect non négligeable d’une croisière est le fait de voyager sans vraiment s’en rendre compte et de se retrouver au petit matin dans des villes, comme Barcelone ou Palma, par exemples, qui ont beaucoup à offrir en matière d’architecture, de références historiques, d’atmosphère, de senteurs. Mais cette expérience m’avait suffi. Ces palaces, que dis-je, ces villes flottantes me fascinaient, mais plus par leur aspect technique et humain que par la quantité de distractions offertes à bord. J’avais apprécié ce voyage mais plus pour les longues heures sur le pont
à regarder la mer ou à converser avec les marins et le reste du personnel que par le côté clinquant et surfait des animations qui donnent à monsieur tout le monde, pour un prix défiant toute concurrence, l’impression d’être un riche personnage issu du feuilleton « la croisière s’amuse ». Tout cela pour dire que je n’eus aucune peine à décliner l’invite de mes parents à les accompagner sur les flots bleus de la Méditerranée et à leur dire que je préférais opter pour un plan vacances balnéaires en Turquie avec mes potes, choisissant l’une des nombreuses offres bon marché et « all-inclusive » que l’on trouvait dans les agences de voyages pour la région d’Antalaya.
Nous ne doutions de rien. Nous avions dix-huit ans et nous sentions indestructibles.
Notre plan était simple : trouver le moyen, pour Marwan, de se faire passer pour un candidat au Jihad. Ensuite, une fois les contacts pris, nous avions prévu de nous rendre en Turquie, à la frontière syrienne, munis de tous les contacts nécessaires pour passer la frontière et rejoindre un groupe rebelle. Marwan pensait que je devais rester prêt, en Turquie, à l’aider à sortir de Syrie avec Abdel une fois qu’il l’aurait récupéré et qu’ils auraient réussi à déserter puis à rallier la zone frontière. Au besoin, je pourrais m’adjoindre les services de peshmergas kurdes qui détestaient ces jihadistes et ne cracheraient pas sur un coup de pouce financier pour m’accompagner en Syrie et me seconder dans l’exfiltration de mes amis.
Pour financer notre expédition, nous avions décidé de mettre en commun nos économies. C’est là que j’eus la première surprise financière de ma vie. Je mettais sur un compte bancaire jeunesse, à la banque cantonale, le surplus de mon argent de poche, les cadeaux de mes parents ainsi que ce que je gagnais dans mes petits jobs d’étudiants. En allant m’enquérir de l’état de mon compte, et sans doute en raison de mon accession récente au statut d’adulte, je fus étonné de me voir poser la question : « le compte jeunesse ou le compte-épargne ? ». Et c’est là que je découvris un compte d’épargne de près de 100 000 francs dont j’apprendrai plus tard qu’il s’agissait d’une bonne partie de l’argent que Mamounette avait subtilisé à Jo, peu avant notre départ de Montpellier. Cela dépassait largement les 3000 frs que j’avais sur mon compte jeunesse et les 6000 frs de Marwan. Je décidai de prélever intégralement ce que nous avions estimé nécessaire à notre expédition, et même un peu plus, sur ces économies providentielles.
Nous nous étions jurés, évidemment, de ne pas toucher un mot de notre projet à nos parents et même à Merce. Nous avions informé Xavier, en lui faisant promettre le silence, pour qu’il y ait au moins une personne, en cas de pépin, qui puisse savoir où nous étions.
Nous étions complètement inconscients et totalement ignorants de ce qui nous attendait.
La première déception vint de la visite de Marwan à une mosquée du canton de Berne, réputée pour prêcher un islam très strict. S’étant ouvert de ses projets à l’imam du lieu, Marwan eut la surprise de se faire sermonner vertement. Non, l’imam n’avait aucun contact permettant de faciliter le départ
d’éventuels volontaires pour le Jihad, fusse pour aller combattre un tyran. La guerre sainte n’était plus d’époque et ceux qui la pratiquaient, le plus souvent le faisaient par goût de l’aventure, l’appât du gain (les groupes extrémistes payaient bien leurs volontaires) ou après un véritable lavage de cerveau. Les exactions commises par ces combattants déshonoraient l’Islam et insultaient Dieu, la religion et tous les croyants sincères qui ne demandaient qu’à pratiquer leur religion et vivre en paix avec tous leurs semblables, y compris avec les adeptes d’autres religions et même ceux qui n’en pratiquaient aucune.
L’Imam menaça Marwan d’informer ses parents ou même les autorités. Ce dernier fit amende honorable, reconnut la folie de son projet et demanda même à l’Imam, pour le dissuader de mettre ses menaces à exécution, de prier avec lui pour l’aider à trouver une voie plus constructive de vivre sa foi. Marwan quitta ensuite la mosquée et reprit, déçu, le chemin de la gare.
En attendant le train pour rentrer, il fut abordé sur le quai de la gare, par un jeune homme d’une vingtaine d’années, qui se présenta et dit s’appeler Ahmed et être franco-algérien. Il dit l’avoir entendu parler à l’imam et lui glissa juste un numéro de téléphone en lui disant de l’appeler s’il persistait dans sa volonté de partir défendre ses frères en Syrie. Puis il disparut dans la foule aussi vite qu’il était apparu.
Arrivé à la maison, il consulta ses courriels et sentit son cœur battre quand il prit connaissance du
message d’un expéditeur inconnu, message qu’il avait d’ailleurs failli jeter comme tant d’autres « spams » ou « pourriels » que l’on reçoit chaque jour. Ce message disait en substance :
Mon cher cousin,
C’est grâce à l’hospitalité et à la générosité d’une famille kurde que je peux t’écrire. Nous avons été recueillis chez le chef du village. J’ai un petit moment pour t’écrire. Je le fais sur le vieil ordinateur portable de la fille du chef.
J’espère que ce mail partira : l’alimentation électrique est fragile et le réseau internet passe par le raccordement téléphonique, peu stable également. Toute la population se prépare à abandonner les maisons et à faire route vers le Kurdistan irakien. Dans une heure environ, ils arrêteront et détruiront le groupe électrogène qui nous fournit l’électricité pour ne pas qu’il tombe entre les mains des jihadistes.
Quand je suis arrivé il y a environ un mois à la frontière turco-syrienne, au rendez-vous que m’avait donné mon « recruteur » en Suisse, il y avait là quelques autres jeunes comme moi : trois français, un allemand, deux anglais, trois maliens et un jordanien. Un syrien est venu nous chercher et nous a fait passer la frontière de nuit. Le lendemain, nous étions dans les environs d’Alep. On nous a tous équipés d’une kalashnikov et mis sous les ordres d’un chef qui parlait très peu l’anglais. Comme je parlais arabe, je traduisais en français ou en anglais ce qu’il n’arrivait pas à nous expliquer.Après deux
journées de ce qu’ils appelaient la formation, nous avons commencé par dégager des décombres pour en sortir des civils qui y étaient restés coincés suite aux bombardement des hélicoptères de l’armée qui larguaient des barils de TNT, à l’aveugle, sur la cité.
Après quatre jours, ils nous ont emmenés à des centaines de kilomètres de là, en camionnettes. Le trajet a duré plusieurs heures et nous avons rejoint un groupe plus important. J’ignorais où l’on se trouvait. Le fait est, qu’à peine la jonction faite avec les autres djihadistes, on a fait le plein des véhicules et nous sommes repartis avec le même groupe qu’au départ d’Alep. Nous étions une trentaine de combattants dont une partie des volontaires arrivés avec moi. Nous avons laissé les véhicules au pied d’une colline caillouteuse que nous avons gravi à pied. Arrivés au sommet, le chef nous a expliqué que nous étions au Kurdistan syrien.
Comme il n’y avait aucune présence de l’armée gouvernementale, nous nous sommes étonnés. Le chef nous a expliqué que l’ennemi n’était pas forcément et uniquement l’armée mais tous les infidèles et tous ceux qui prônaient la décadence. Par décadence, le chef voulait dire tous ceux qui ne pensaient pas comme lui et ses semblables et ne voulaient pas se soumettre à ce que je dois bien appeler maintenant une dictature religieuse, bien que je me demande comment ces gens-là peuvent encore invoquer la religion pour justifier leurs actes.
Il nous a désigné un village en contrebas, sur l’autre versant, en nous disant que nous allions l’attaquer et qu’il fallait tuer tout le monde sauf les femmes et les filles les plus belles que nous allions offrir à nos chefs ou vendre aux combattants les plus méritants. Avec une partie de mes camarades, les deux français et un des maliens arrivés avec moi mais aussi quelques syriens et irakiens, nous avons refusé. Il s’en est ensuivi une bataille rangée que nous avons remportée puisque nous possédions la seule mitrailleuse du groupe et que mon camarade malien avait porté sur ses épaules, en gravissant la colline, la caisse contenant la réserve de grenades. C’était horrible : un vrai massacre : Après une heure de combat, il ne restait que quatre survivants : le malien, un français, moi-même et, dans l’autre camp, le chef qui nous avait harangué et qui avait une sale blessure à la jambe. Avant que je n’aie eu le temps d’intervenir, le malien lui a mis une balle dans la tête en disant que de toute façon il était intransportable et que si les autres jihadistes le retrouvaient, nous allions tous être décapités.
Ensuite nous fîmes route vers le village kurde, avec nos bras en l’air et tenant nos armes par le canon. Le chef parlait arabe et j’ai pu lui expliquer ce qui s’était passé. Il a aussitôt envoyé des hommes récupérer toutes les armes et munitions qui étaient restées sur le champ de bataille au sommet de la colline. Il m’expliqua qu’ils étaient régulièrement victimes d’attaques et de razzias des jihadistes qui se comportaient de manière pire encore que les soldats du dictateur. La pression de ces groupes fanatiques augmentait quotidiennement et les habitants de ce village songeaient maintenant à fuir au Kurdistan irakien, mieux organisé et mieux défendu.. J’étais étonné de voir que parmi les défenseurs du village, il y avait beaucoup de femmes qui étaient considérées et traitées avec le même respect
que les hommes. Et pourtant, tous ici étaient des musulmans pratiquants.
En discutant avec nos hôtes, j’ai appris que les chefs jihadistes avaient des privilèges qui se situaient bien loin des préceptes religieux qu’ils prônaient et prêchaient, comme la consommation d’alcool, le trafic de drogues, l’enrichissement personnel, l’exploitation sexuelle de prisonnières et même de jeunes prisonniers. En plus, pour garder leurs troupes, ils les payaient relativement bien.Certains jeunes européens gagnaient bien moins chez eux, au chômage ou dans des emplois précaires. Pour nos camarades africains, c’était carrément une fortune. Mais combien rentreraient chez eux ? C’est une autre question !!
J’ai découvert qu’ils raflaient des filles et femmes, chiites, chrétiennes, yazidies, dans le but de servir d’esclaves sexuelles en premier lieu aux chefs, ces « émirs », d’abord, mais aussi aux combattants qui n’avaient guère de distractions ou d’occasions de dépenser sur place leur salaire .
J’ai vraiment honte de ce que j’ai fait. J’ai tué des êtres humains, pour sauver ma peau certes, mais j’ai tué quand même et cela me poursuivra le restant de mes jours. En plus, je suis venu ici parce que je me suis persuadé que j’ étais humilié et insulté comme musulman et qu’il fallait défendre mes frères de religion contre un dictateur. Comme pour Saddam Hussein, Khadafi ou d’autres dictateurs, nos pays occidentaux ont soutenu ce tyran syrien par intérêt, pour le pétrole ou d’autres enjeux géostratégiques et surtout économiques. Je n’ai pas réalisé que ceux qui recrutaient des jeunes comme moi n’avaient
pas comme priorité d’abattre le dictateur mais d’imposer par la force leur vision fanatique et tronquée de l’Islam. Les autres rebelles laïcs ou musulmans modérés, ne viennent pas chercher des jeunes en occident. Ils se battent pour la liberté et la dignité, c’est tout.
Le pire, c’est qu’en fait, je ne faisais que réagir par dépit amoureux. J’aurais du écouter le premier Imam que j’avais contacté avant de rechercher un recruteur sur internet. Il m’avait bien dit que partir au combat n’était pas un acte religieux ou une preuve de ma foi et que ces soi-disant jihadistes n’ont, d’après lui, aucun droit à se réclamer de l’Islam parce que tout ce qu’ils font est contraire à la religion. Surtout, ils mettent en danger les musulmans du monde entier à cause de l’inévitable amalgame que font les racistes bas du plafond ou les partis d’extrême-droite en occident. Et le meilleur moyen, d’après lui, d’arrêter ces guerres et le fanatisme aveugle, est d’arrêter de soutenir ces régimes dictatoriaux et de rétablir la justice sociale dans ces pays : le fanatisme se nourrit du désespoir mais a peu de chance de se développer chez des gens qui mangent à leur faim, vivent décemment et en liberté. Donc, si je voulais vraiment soutenir mes frères syriens, il y avait assez d’organisation humanitaires ou même de groupes rebelles démocratiques que je pouvais soutenir par mes prières et mes dons. J’aurais vraiment du l’écouter !!
J’essaierai de te contacter quand on sera au Kurdistan Irakien. Je voudrais tant rentrer chez moi !! Je n’ai plus un sou et j’aurai besoin de toi pour le voyage du retour. Pardonne-moi cousin, pour mon inconscience et ma bêtise ! Mes deux compagnons, le français et le malien, eux aussi, n’aspirent plus
qu’à retrouver leurs familles qui vivent en France.
Mais comment faire ? On verra…Inch Allah !
Si tu veux me dire quelque chose, réponds à ce mail dans les dix minutes qui suivent, après, je ne sais pas comment je pourrai te contacter. Mes hôtes ont des téléphones portables mais ils les économisent et vont les charger jusqu’à notre départ, d’ici une heure ou deux.
Ton cousin Abdel qui espère te revoir.
Marwan répondit simplement à Abdel : « Je viens te chercher. Fais tout ce que tu peux pour me dire où tu seras. Je peux aussi recevoir tes mails sur mon téléphone et si tu peux disposer d’un appareil, appelle-moi ou lance un message. Tiens bon. Je t’embrasse ».
Puis il se précipita sur le téléphone et m’appela :
– J’ai reçu un mail d’Abdel
– Ah bon, il est où ?
– Encore en Syrie mais chez les Kurdes. Il essayait de passer au Kurdistan irakien avec les habitants d’un village qui fuient les Jihadistes.
– Cela change la donne pour nous. Plus question que tu ailles en Syrie en te faisant passer pour un volontaire.
– Ouais, je suis d’accord. Mais qu’est-ce que je fais avec ce numéro de téléphone du mec qui m’a abordé à Bienne ?
– Tu le files à la police en expliquant ce que tu as voulu faire et pourquoi. Si on peut éviter que d’autres se fassent avoir, c’est déjà ça de gagné. Et le mec, ça lui sauvera peut-être la vie. Mais fais-le par courrier, il ne faudrait pas que la police t’interroge ou te retienne avant qu’on parte.
– OK, je vais m’en occuper. Mais pour Abdel ?
– On va aller le chercher.
– Mais où, on ne sait même pas où il est !
– On trouvera. Il va sûrement te recontacter. Je m’occupe de recenser toutes les ONG qui travaillent en Turquie et au Kurdistan irakien. Il y en a bien une qui acceptera des volontaires pour quelques semaines. Pour le moment, occupe-toi du numéro de téléphone et informe aussi l’Imam qui t’a fait la leçon. Il mérite de savoir qu’on a stoppé un extrémiste qui utilise sa mosquée. Il sait que ces gens-là recrutent des jeunes en perdition ou des accrocs à la violence appâtés par la promesse des jihadistes de faire en vrai ce qu’ils font dans leurs jeux vidéo guerriers.
– OK, je vais le faire.
– Quant à moi, je commence tout de suite les recherches sur internet et je passe chez toi ce soir.
– Ça marche, à toute.
Comme j’aurais du m’y attendre si j’avais été un peu moins naïf, aucune ONG n’acceptait de « stagiaire ». A chaque téléphone je recevais le même message : Finissez vos études et reprenez contact à ce moment-là. Nous verrons alors s’il sera possible d’utiliser vos compétences.
Marwan, de son côté, avait repris contact avec l’Imam et l’avait informé de la présence de ce «recruteur » parmi les fidèles de sa mosquée. Nous apprîmes plus tard qu’avec quelques fidèles, ils avaient organisé une surveillance et pu identifier non seulement le jeune qui m’avait contacté,
mais deux comparses. Ils dénoncèrent le groupe à la police qui les arrêta. Suite à cette interpellation et en collaboration avec la police française de Lyon, un réseau opérant en France et en Suisse put être démantelé. Ce réseau gérait, par ailleurs, deux sites internet dont celui par lequel Abdel avait été recruté.
Il nous restait à peine deux semaines pour agir si nous voulions le faire avant la fin des vacances scolaires d’automne. Nous décidâmes donc de prendre un « last minute » pour la Turquie , en choisissant une destination la plus proche possible de la frontière que nous pensions rejoindre par les transports publics locaux.
Nous découvrîmes une offre pour un séjour balnéaire de cinq jours dans la petite ville de Yumurtalik située bien plus à l’est que les grands complexes touristiques de la région d’Antalya. Nous avions prévu de nous rendre à Nusaybin, à plus de 500 kilomètres, une ville frontière juste en face de la ville syrienne de Qamishli par laquelle transitaient beaucoup de réfugiés.
Deux jours plus tard nous étions à Yumartalik. Par je ne sais quel hasard, l’hôtelier était un Yasidi, cette peuplade non musulmane de culture kurde. D’origine irakienne mais détenteur d’un passeport turc, il avait vécu plusieurs années en France et en Allemagne.Il s’était acheté ce petit hôtel avec ses économies et se plaisait dans cette bourgade tranquille malgré le fait qu’elle ne se situait pas en
zone kurde. Il gérait son établissement avec l’aide de son épouse et de ses deux fils qui devaient avoir notre âge pour le plus jeune et peut–être trois ou quatre ans de plus pour l’aîné. Nous sympathisâmes tout de suite et passâmes la première soirée à bavarder à bâtons rompus. Mis en confiance, nous lui confiâmes nos projets et la raison qui nous amenait ici.
Il proposa spontanément que son fils nous amène à Nusaybin, moyennant la seule prise en charge des frais d’essence. Nous ne savions comment lui exprimer notre reconnaissance. Il ajouta simplement que si l’un de ses fils avait fait la même bêtise qu’Abdel, il aurait, lui aussi, remué ciel et terre pour le ramener au bercail. Si nous tenions vraiment à le remercier, il nous dit simplement que ce serait peut-être à nous, qui sait, d’accueillir un jour un de ses enfants en Suisse, si d’aventure l’hôtel venait à péricliter et à ne plus pouvoir nourrir toute la famille.
Le lendemain, nous prenions la route en direction de l’est. Plus de 500 kilomètres nous séparaient de notre but. Nous atteignîmes notre destination après sept heures de route environ. La frontière faisant une sorte de boucle à cet endroit, la cité de Nusaybin est presque enclavée dans le territoire syrien qui la borde par trois côtés. Nous passâmes près d’une heure à trouver enfin un hôtel et de surcroît doté d’un Wi-Fi : la plupart des établissements étaient plein de journalistes venus couvrir la guerre civile en Syrie ainsi que de quelques humanitaires qui prenaient leurs moments de repos dans des hôtels de la place, histoire de reprendre des forces et sortir quelques instants de l’agitation, de la misère et du stress dramatique des camps de réfugiés.
Une fois installés, nous réalisâmes que nous n’avions aucun plan et surtout aucune idée de la manière dont nous pourrions retrouver Abdel. Louer une voiture fut la première étape puisque passer en Syrie nous semblait une évidence nécessaire. Mais pour aller où ? Comment savoir où pouvait être Abdel ? Un journaliste belge, correspondant de son journal en Turquie, rencontré dans le hall de l’hôtel, nous fit un bref topo de la situation : de l’autre côté de la frontière, il y avait les troupes gouvernementales, des groupes de l’armée syrienne libre qui représentaient l’opposition laïque ou musulmane modérée. Un peu plus loin on trouvait aussi des milices chrétiennes syriaques, une communauté présente dans la région depuis presque deux millénaires, qui étaient autrefois assez proches du pouvoir, ce dernier ne s’étant jamais pris aux chrétiens. Mais il y avait enfin et surtout, les combattants de « daech » que l’on appelle aussi l’Etat Islamique qui représentaient la force la plus puissante, la mieux payée et la mieux organisée. Mais ces jihadistes passaient plus de temps à combattre les autres forces d’opposition et les Kurdes qu’à s’attaquer aux troupes du dictateur. On murmurait qu’ils rêvaient de restaurer un califat sur toute la région avec l’ambition de l’étendre ensuite au monde entier en semant partout la terreur et l’obscurantisme.
Mais il y avait enfin et surtout, les combattants de « daech » que l’on appelle aussi l’Etat Islamique qui représentaient la force la plus puissante, la mieux payée et la mieux organisée. Mais ces jihadistes passaient plus de temps à combattre les autres forces d’opposition et les Kurdes qu’à s’attaquer aux troupes du dictateur. On murmurait qu’ils rêvaient de restaurer un califat sur toute la région avec
avec l’ambition de l’étendre ensuite au monde entier en semant partout la terreur et l’obscurantisme.
Le journaliste nous déconseilla tout passage de la frontière : on parlait d’enlèvements d’occidentaux et c’était pure folie que de s’aventurer de l’autre côté dans ce contexte. Nous étions désespérés. Marwan relevait ses mails toutes les 5 minutes dans l’espoir qu’Abdel trouverait le moyen de les contacter.
Il était presque minuit quand arriva enfin un message d’Abdel sur le téléphone de Marwan.
Il disait simplement : « sommes maintenant en face de Kavaközü ».
Nous allâmes immédiatement tambouriner à la porte du journaliste belge. Ce dernier était en discussion via Skype avec sa rédaction à Liège. En voyant nos têtes, il interrompit la liaison et signala à ses collègues qu’il les recontacterait plus tard.
Je lui laissai à peine le temps de prendre congé de ses collègues
– Kavaközü, vous connaissez.
– Oui, c’est une petite ville au bord du Tigre, à environ 120 kilomètres à l’Est.
– Notre ami vient de nous envoyer un message, il est en face.
– Sûrement puisqu’il cherche à en sortir.
– La ville est au bord du Tigre. Si je me rappelle, il y a une île inhabitée au centre du fleuve et l’un des bras passe du côté turc et l’autre du côté syrien. Sauf erreur, l’île doit être sur territoire turc. S’il est en face, il doit être sur la rive syrienne face à l’île.
– Il y des villages, un pont, quelque chose du côté syrien ?
– Non, il n’y a rien et c’est probablement pour ça que votre ami est là. Avec tous les combats en cours, il risque bien plus sur les routes et dans les zones habitées. Il y a bien une route qui suit plus ou moins le cours de la rivière mais à quelques kilomètres à l’intérieur des terres.
– Comment on peut traverser ?
– En bateaux ou à la nage !
– Vous connaissez quelqu’un là-bas ?
– Non, mais mon traducteur est de Bostanci, une autre bourgade au bord du fleuve mais quelques kilomètres plus au sud. C’est comme ça que je connais l’endroit : il m’a emmené une fois dans sa famille sur laquelle j’ai fait un reportage l’an passé. Nous sommes passés par Kavaközü. Je peux éventuellement le contacter et lui demander s’il connaît quelqu’un qui pourrait vous faire traverser le fleuve et ramener votre ami.
– S’il vous plaît, faites-le !
Il s’interrompit 5 minutes et appela son traducteur avec qui il conversa en anglais. L’homme non seulement avait un cousin à Kavaközü propriétaire d’une grosse barque à moteur mais en plus, mis au courant de notre projet, il se proposait de nous emmener là-bas, d’attendre que nous récupérions Abdel, et enfin de nous ramener ici, le tout pour 200 euros, frais de carburant non compris. C’était dans nos possibilités et surtout inespéré ! Nous acceptâmes à condition de pouvoir partir tout de suite. Nous décidâmes donc de laisser la voiture de location à l’hôtel et de ne l’utiliser qu’une fois de retour ici. Quarante minutes plus tard, nous avions payé notre nuit et deux jours supplémentaires à venir, mangé un kebab, fait le plein de bouteilles d’eau et le traducteur débarquait à l’hôtel. Nous embarquâmes immédiatement dans son véhicule. J’étais épuisé, tendu, inquiet. Marwan se chargea de la conversation pendant les deux heures que dura le trajet.
En roulant, je me disais que notre situation avait quelque chose d’irréaliste. Il y a quelques heures à peine, nous étions des touristes en vacances balnéaires et trois jours plus tôt, nous étions chez nous, en Suisse. Là, maintenant, nous faisions route, dans la nuit, à quelques centaines de mètres d’un pays déchiré par la guerre civile et où des milliers de familles vivaient des deuils et la perte totale de leurs biens.
Et dire que chez nous certains pétaient un câble ou faisaient des quasi dépressions pour un mot de travers, un voisin enquiquineur, un petit chef autoritaire et bas du plafond, un chagrin d’amour ou une amende pour excès de vitesse. En même temps, loin de leur jeter la pierre, je me disais aussi que dans le moment, pour ces gens-là, leur souffrance était réelle, subjective mais authentique même si, vu d’ici et aujourd’hui, ce genre de petits bobos m’apparaissaient dérisoires et pathétiques en diable.
Pendant le trajet, Marwan envoya plusieurs textos au numéro qui avait envoyé le message d’Abdel en espérant qu’il les reçoive. Il disait que nous allions trouver un moyen de venir le chercher sur l’autre rive. Il n’ y eut aucune réponse.
Le chauffeur s’arrêta à l’entrée du village. Nous fîmes quelques pas à pied et il frappa à une porte. Un homme aux cheveux gris nous ouvrit. Après quelques minutes de palabre, il rentra et ressortit aussitôt de sa maison avec un jerrycan d’essence puis nous fit signe de le suivre jusqu’au bord du fleuve. D’un bosquet voisin, il tira une barque sur la rive caillouteuse, fit le plein du moteur et en expliqua le
fonctionnement au traducteur qui nous répéta les consignes en anglais.
– Il ne nous accompagne pas ?
– Non, il dit que c’est trop dangereux avec tous les soldats et les fous qui se battent de l’autre côté. Depuis trois jours, c’est calme mais la semaine passée, il a souvent entendu des coups de feu. Il faut le payer maintenant. Il demande 100 euros et 300 de garantie pour la barque. Je lui donnerai de la monnaie locale mais pour vous, ça fera 400 euros et je vous en rendrai 300 si vous revenez vivants et avec la barque. Je vous demande aussi de me payer maintenant pour les trajets. Je vous attends 3 heures au maximum. Passé ce délai ou si j’entends des coups de feu quand vous êtes de l’autre côté, je rentre à Nusaybin !
J’avais déjà piloté de petits bateaux à moteur et je lançai l’embarcation dans le courant, heureusement pas trop fort en cette saison. Nous dûmes contourner l’île par le sud pour remonter lentement le courant en longeant la rive syrienne. Après trente minutes de navigation, nous n’apercevions toujours rien. Il était presque cinq heures du matin et nous avions crainte que le l’aurore n’apporte avec elle toutes sortes de dangers dont et surtout les guerriers qui devaient en vouloir à Abdel d’avoir déserté. C’est alors que Marwan m’interpella :
– Là, j’ai vu une lumière. Reviens un peu arrière et repasse lentement !
– Oui, j’ai vu comme un éclair. Un briquet peut-être.
– Essaie d’appeler ?
Marwan appela Abdel. Presque aussitôt, nous entendîmes, à quelques dizaines de mètres de nous, sur la rive :
– Par ici mais tais-toi !
– Abdel c’est toi ? vraiment !
– Oui, mais fais vite je t’en supplie.
Nous approchâmes le bateau de la rive et vîmes aussitôt Abdel, accompagné de deux hommes : un de type africain, l’autre à la peau plus claire mais avec des traits qui pourraient faire penser à une origine maghrébine. Il sautèrent dans la bateau et Abdel se contenta de me dire « vas-y, fonce, éloigne-toi, vite ! ».
Arrivés sur l’autre rive, Le traducteur et le vieil homme nous attendaient. Le propriétaire de la barque nous remboursa ce qu’il avait promis et nous partîmes illico pour Nusaybin, accompagnés d’Abdel et de ses deux compagnons.
Pendant le trajet, Abdel nous raconta leur fuite avec les villageois vers le Kurdistan irakien.
Ils roulaient de nuit en évitant les agglomérations, empruntant des chemins à peine carrossables ou à plusieurs reprises les véhicules des villageois s’embourbèrent. Ils avaient tremblé en entendant le son des combats ou pleuré en traversant des villages, semblables aux leurs, détruits et parsemés de corps sans vie. A un moment donné, le chef du village leur conseilla de tenter de passer en Turquie plutôt que de les accompagner jusqu’au Kurdistan irakien. Leur présence non seulement alourdissait la charge des quelques véhicules encore en état de marche mais en plus, s’ils rencontraient des groupes de jihadistes ou même de l’armée régulière, la présence de jeunes étrangers ne pourrait que leur attirer des ennuis. Le convoi fit donc un détour de quelques kilomètres pour les rapprocher de la frontière. Le chef leur indiqua la direction à prendre et leur laissa, pour se défendre au cas où, une kalashnikov et deux chargeurs, qu’ils avaient ensuite jetés dans le fleuve au moment où nous les avions récupérés. Son téléphone n’avait plus batterie pas plus que ceux de ses compagnons. C’est pour cela qu’il ne pouvait répondre aux messages de Marwan.
Arrivés à Nusaybin, nous prîmes conseil auprès du journaliste belge pour savoir que faire avec les deux compagnons d’Abdel, l’un ressortissant français, l’autre malien résidant sur le territoire français, mais les deux dépourvus de passeports. Il se proposa de les accompagner à Ankara, à l’ambassade de France, pour organiser leur rapatriement, en échange d’un interview complet, couvert par l’anonymat évidemment, sur leur épopée. Sachant pourtant qu’ils risquaient des poursuites judiciaires pour leur engagement irréfléchi au sein de ces groupes jihadistes, ils acceptèrent sans hésiter, n’ayant pour le moment qu’un seul souhait : retrouver leurs familles et reprendre, si tant est que cela soit encore possible, une vie normale loin de cette folie meurtrière. Un dernier incident émailla encore cette journée :
Au moment de prendre congé des compagnons d’Abdel, alors que nous nous apprêtions à quitter le bar de l’hôtel où résidait le journaliste, Abdel sursauta et montra quelque chose, dans la rue, à ses deux compagnons. Les trois jeunes hommes affichèrent simultanément une expression de peur qui nous étonna. Je demandai à Abdel ce qui se passait :
– Là, dans la rue, je les ai vus.
– Qui ?
– Ces deux-là, dit-il en nous montrant, de l’autre côté de la rue, deux individus dans la vingtaine, habillés comme des touristes occidentaux.
– C’est qui ?
– Deux jihadistes du premier groupe dans lequel nous étions près d’Alep. L’un des deux est anglais, l’autre allemand. Ils avaient une réputation de cruauté au combat qui nous faisait peur. Au début, je croyais qu’ils fanfaronnaient mais après avoir discuté avec d’autres combattants, nous avons appris qu’ils n’avaient pas usurpé leur réputation : ils avaient égorgé des civils à l’arme blanche, violé et battu à mort des femmes pas assez voilées à leur goût. Ils vivaient leur combat de la même manière dont ils devaient chez eux, en Allemagne ou au Royaume-Uni, jouer à ces jeux de guerre ultra-violents auxquels tant de jeunes sont accrochés.
– Et qu’est-ce qu’ils font de ce côté-ci de la frontière ?
– Ils doivent être au repos. Tu sais, il y a en Turquie, dans plusieurs localités frontalières, des maisons secrètes achetées ou louées à prix d’or, où ces fanatiques stockent des armes, soignent leurs blessés ou les laissent se reposer. On raconte qu’ils y ont même séquestré des femmes destinées à servir d’objets sexuels aux combattants méritants au repos.
– Et la police turque ne fait rien ?
– Certains policiers essaient de les débusquer et de les arrêter mais beaucoup acceptent quelques billets pour fermer les yeux. Comment crois-tu qu’ils pourraient recruter et faire passer tous ces jeunes en Syrie s’il n’y avait pas une tolérance, voulue ou achetée, en Turquie ? !
– On va les suivre !
– Tu veux te faire tuer ? Il n’en n’est pas question !
– Ouais, mais si peut les localiser et les dénoncer, c’est toujours ça de gagné.
– Tu es fou Marwan, tu ne les connais pas !
A ce moment-là, le journaliste intervint dans la conversation et proposa d’accepter la proposition d’Abdel mais en agissant avec précaution. Il proposa donc aux trois jeunes rescapés de s’enfermer dans sa chambre d’hôtel pour éviter que les deux individus ne les reconnaissent. Quant à nous trois, il proposa que l’on se contente de suivre ces deux individus en espérant qu’ils nous mènent à l’une de leurs cachettes, de les photographier discrètement, histoire de pouvoir transmettre leurs portraits
aux autorités de leurs pays respectifs et, à tout hasard, à la police locale en y ajoutant une photo de leur cachette. Même si nous savions pertinemment qu’ils allaient poursuivre leurs horreurs une fois de retour en Syrie, nous n’avions pas d’autres moyens de faire quelque chose dans l’immédiat.
Le problème, c’est que l’on ne s’improvise pas détective et que la filature est un art qui nous était étranger. Nous ne tardâmes donc pas à être repérés. Après avoir tenté de nous semer dans le dédale des ruelles, ils nous amenèrent sur un chantier abandonné, à côté d’un terrain vague, à l’arrière d’un pâté de maison où nous venions de les perdre de vue. Le temps de scruter les alentours, nous les vîmes avec horreur qui s’élançaient dans notre direction. Ils tenaient chacun un couteau dont ils nous menaçaient. Sans attendre, le journaliste fit tournoyer son appareil de photo par la sangle et frappa à deux reprises la tête d’un de nos agresseurs. L’appareil n’y survécut pas mais l’agresseur se retrouva à terre, inconscient .Pendant ce temps, Marwan s’était emparé d’un fer à béton trouvé par terre et faisait lâcher son arme au deuxième en lui assénant un violent coup sur l’avant-bras. Ensemble, nous le fîmes basculer par terre et lui liâmes les mains dans le dos avec ma ceinture. Le premier était étendu sans connaissance, assommé à coup d’appareil de photo. Sans perdre son sang froid, le journaliste les photographia à plusieurs reprises avec son téléphone portable. Il envoya immédiatement les photos à son journal, à la police turque et même à un ami policier dans un commissariat de Liège.
– Comme ça je suis sûr, même si je me fais trucider par un de ces allumés, que leurs trombinettes seront connus de ceux qui peuvent les arrêter. Et je dirais qu’ils ont même avantage à se faire
arrêter : si on publie leurs portraits dans les journaux, ce sont leurs émirs qui leur feront la peau pour s’être laissés prendre.
– Vous êtes sûr qu’on peu les laisser ici.
– Pas le choix, jeune homme ! Et maintenant, on retourne aux voitures et on se tire fissa de cette ville.
Nous n’avions effectivement pas d’autre choix que de les laisser là, à terre dans ce terrain vague, entravés et bâillonnés par tout ce que nous avions pu trouvé sur nous, sur eux ou dans les parages : nos ceintures, leurs T-shirt déchirés , des restes de fils de fer, de la ficelle.
Nous regagnâmes ensuite l’hôtel en courant. Notre ami belge régla sa note pendant que nous récupérions les trois jeunes à l’étage. Cinq minutes plus tard, nous étions aux véhicules. Abdel, Marwan et moi prîmes la direction de la Méditerranée et les autres celle d’Ankara
Nous décidâmes de rallier Yumurtalik dans les meilleurs délais. De là-bas, nous pourrions contacter la famille d’Abdel afin qu’elle lui procure un billet d’avion Antalya–Genève dans les plus brefs délais.
Nous retrouvâmes avec émotion l’hôtelier, son épouse et ses deux fils qui nous avaient si bien accueillis et aidés au delà de ce que nous espérions. Il nous restait deux jours de vacances que nous employâmes à dormir beaucoup, à nager un peu et à bavarder avec nos hôtes, ces derniers étant effarés des récits que leur faisait Abdel et qui, malheureusement, confirmaient ce qu’ils soupçonnaient déjà de la situation en Syrie.
Les jours passés, je m’étais efforcé de rassurer Merce et mes parents en envoyant régulièrement des messages avec des photos de plages prises le premier jour à Yumurtalik ou dégottées sur internet. Marwan en avait fait autant avec ses parents. Ce que j’ignorais, c’est que Xavier, harcelé par Merce pour savoir ce qui se cachait derrière cette brusque envie de vacances balnéaires avec Marwan, avait fini par lâcher le morceau. Et c’est ainsi, qu’en débarquant à Genève, j’aperçus derrière la vitre, non seulement les parents de Marwan et ceux d’Abdel, mais aussi Merce que je pensais appeler dès mon retour au village.
A peine avais-je franchi la porte que Merce se jeta sur moi et me colla la plus magistrale baffe que je n’avais jamais reçue en s’écriant :
– Mai mes ! nunca mas ! plus jamais ça ! t’estimo tant ! te quiero tanto ! idiota !!
– Répète ça doucement en m’épargnant le catalan et le castillan s’il te plaît.
– Ne me fais plus jamais ça imbécile ! Je t’aime tellement….
Je la pris dans mes bars où elle sanglota encore un moment avant de me dire que Marwan et moi étions complètement insensés. Courageux peut-être, mais fous quand même. Elle répéta qu’elle ne voulait pas faire sa vie avec quelqu’un qui lui donnerait trop souvent ce genre d’angoisse. Je la rassurai, pris congé de Marwan et d’Abdel qui, avec leurs familles respectives, empruntèrent la route de Fribourg.
Je connaissais assez peu Genève et nous décidâmes de nous offrir un moment de quiétude à nous balader au bord du lac avant de reprendre un train pour rentrer chez nous. Ensuite, nous regagnâmes mon domicile. Mamounette et Paolo ne devaient rentrer de croisière que 3 jours plus tard et nous avions la maison pour nous.
Je ne te décris pas ce qui a suivi : je ne suis pas très doué pour les récits érotiques qui, de toutes façons, ne sont jamais à la hauteur de la réalité. Ce qui est sûr, c’est que ces deux jours ont confirmé le fait que Merce est toujours ma compagne aujourd’hui.
– Tu remarqueras que je ne t’ai pas interrompu alors que ce n’est pas l’envie qui m’en manquait. Mais là, je dois dire que tout ça dépasse ce que j’aurais pu imaginer de ta vie avant que ne deviennes mon stagiaire puis mon collègue. Tu n’as pas l’impression des fois d’attirer la poisse, ou au contraire
l’excès de chance, de baraka ?
– Non je t’assure, je ne me sens pas différent des autres. Je ne sais pas si je minimise ce qui m’arrive ou si je suis inconscient, mais à chaque épisode un tant soit peu dramatique de mon existence, j’ai d’abord l’impression de me liquéfier d’angoisse avant de réagir de manière purement instinctive puis, une fois les événements passés, de me consolider et de vivre encore plus intensément qu’avant.
– Ouais… Mais tu as quand même une chance de cocu de t’en sortir aussi bien à chaque fois. Et pourtant, je t’ai vu craquer, ou presque, pour des évènements bien plus futiles que ce que tu as vécu, par exemple des critiques de collègues ou de parents.
– Je sais, c’est paradoxal. Mais dans le moment, ces petites attaques, ces doutes que l’on distille à mon encontre, ces remarques malveillantes me touchent et me blessent profondément
– Tu es vraiment quelqu’un de particulier mon cher Isidore…
– Pas vraiment, non ! Par exemple, je ne me sens pas tellement différent de toi. A part, bien sûr, que je suis infiniment plus jeune, plus sportif, plus beau que ce vieux crouton qui me sert de modèle et de confident depuis quelques années…
– Ben oui, je te l’ai déjà expliqué mille fois : ça veut dire plus ou moins « ça marche », « d’accord ».
– Alors je t’écoute.
Difficile de reprendre une vie de lycéens après ce que nous avions vécu. Xavier nous pressait de questions, surtout Marwan qui avait eu infiniment plus de détails par Abdel. Mais au bout de quelques jours, nous ne voulions plus parler de tout ça.
Abdel, qui avait interrompu une formation d’électricien pour partir en Syrie, s’était trouvé un nouvel employeur et suivait les cours de l’école professionnelle en Valais. Il avait trouvé à se loger dans un foyer d’apprentis où il se plaisait et ne revenait voir sa famille qu’un week-end sur deux. Changer de canton et d’entourage ne pouvait que lui faire du bien. Son épopée syrienne était tenue top-secret par toute sa famille et ses amis. En parler lui aurait amené des ennuis avec les autorités judiciaires et pouvait peut-être, même s’il s’était engagé sous un pseudonyme, lui attirer la vengeance de ces fanatiques.
Le jeune homme qui m’avait abordé à Bienne et dont nous avions fourni le téléphone à l’Imam, avait craqué lors de son arrestation. Il avait donné tout le réseau de recruteurs qui opérait sur la Suisse à
partir de Thonon et de Lyon. Il avait parlé grâce à la promesse d’une protection, de l’anonymat garanti et de la permission de rester en Suisse. Le contact d’Abdel sur internet faisait partie du groupe mis hors d’état de nuire par la police française. Il n’y avait donc que peu de chance que ce réseau puisse encore nuire à Abdel dont ils ignoraient la véritable identité.
Je continuais de m’interroger sur ce qui pouvait pousser des jeunes gens à s’engager dans ces groupes fanatiques dont il devenait évident qu’ils allaient encore pousser plus loin cette surenchère criminelle et barbare qui n’avait, comme le disait l’imam et quantité d’autres musulmans, rien à voir avec leur religion. Ils ne servaient que les intérêts de leurs chefs fanatisés et avides de pouvoir. L’histoire, comme tu le sais déjà, allait nous donner raison avec la montée en puissance de « l’état islamique» ou «Daech», qui malgré ses succès guerriers, tient plus de l’organisation criminelle et mafieuse que d’une organisation religieuse.
Certains jeunes ne voient là qu’une manière d’extérioriser leur révolte contre une société qui ne leur offre qu’un avenir de chômage et de précarité. Pour d’autres, c’est une manière de réagir contre l’hypocrisie occidentale qui a soutenu tant de dictateurs pour des intérêts économiques avant de s’en distancer et, parfois même, qui avait armé ceux-là même qui aujourd’hui massacrent allègrement en Syrie et en Irak.
Mais je t’avoue que la géopolitique commençait à me fatiguer et que je n’aspirais qu’à une petite vie heureuse. Petite peut-être mais confortable, épanouissante et exempte de la question que se posent des millions d’êtres humains : survivront-nous à demain ? C’était, et c’est toujours, jouer un peu à l’autruche que de raisonner ainsi, mais je prétends que c’est là le souhait de l’immense majorité de la population de cette planète. J’avais la chance de vivre dans un pays où cela était possible et je me disais que je ne changerais rien à l’avenir du monde en me mortifiant et en me culpabilisant de vivre là où je vivais : dans un pays où la paix, la démocratie et la solidarité non seulement ont encore une signification mais surtout, sont possibles.
J’ai donc repris ma « petite vie », avec ses petits soucis, ses grandes joies, ses ambitions satisfaites ou ses espoirs déçus.
C’était l’année du bac et comme Marwan et Merce, je mis un point d’honneur à travailler au maximum pour gagner cette clé qui ouvre le choix d’études supérieures. Après ces événements de l’automne, nous n’avions pas vraiment le cœur à la fête et nous nous contentions, durant cette année scolaire, de quelques sorties en montagne ou à skis, histoire de décompresser.
Nous évitions les fêtes, les sorties en boîtes et, sans être des abstinents militants, nous limitions au maximum la consommation d’alcool que, de toute façon, Marwan évitait plus par tradition familiale que par conviction religieuse.
Nous préférions, lors de nos retrouvailles et de nos escapades montagnardes, évoquer l’avenir et le sens de la vie. Nous passions la plupart de nos instants partagés à réviser nos cours ou à pratiquer ce que nous appelions la philosophie du temps perdu : vivre le moment présent intensément même s’il était rempli d’activités aussi futiles qui n’allaient certainement pas changer la face du monde, telles que la marche, la grimpe ou la lecture d’un bon roman.
Merce, réaliste en diable et pas idéaliste pour un sou, était convaincue que l’humanité allait droit dans le mur : trop de pollution, d’injustices, de disparités Nord-Sud, de démographie non contrôlée, de migrations inévitables, d’idéologies nationalistes et d’extrémismes religieux . Elle était persuadée que tout cela nous conduirait, ou nos descendants, à un grand collapse d’où sortirait peut-être, une humanité meilleure…jusqu’à ce que l’histoire se répète ! Elle prenait avec réalisme et philosophie l’hypocrisie actuelle qui crie au secours face au réchauffement climatique, à cette planète qui se déglingue mais qui, en même temps, ne taxe pas les carburants pour les avions et rend un vol dix à vingt fois meilleur marché, et surtout plus rapide, que le train ou le bateau. De même, certaines autorités politiques tirent la sonnette d’alarme face au trafic automobile individuel, responsable d’une bonne partie des émissions de CO2 mais ne font rien pour le restreindre au profit des transports publics.
Les choses changeront Isidro, se plaisait-elle à répéter, le jour où nous y serons obligés. C’est normal que chacun veuille vivre en paix et garder son confort, son train de vie et que ceux qui en ont été privés, entre autres à cause de l’agressivité économique de nos pays, viennent chez nous pour les trouver. Un jour ça n’ira plus et on sera obligés de vivre autrement. Alors là, peut-être que le monde changera en mieux, ou en pire, qui sait ?
Pour ma part, je pensais que nous pouvions influencer le cours des choses en nous engageant, en changeant notre mode de vie, en pratiquant la solidarité, en nous engageant en politique ou pour la communauté. Mais je savais aussi que cette position comportait une part de déni : je n’étais pas prêt, comme tant d’autres, à accepter, pour sauver l’humanité, de renoncer aux voyages, au confort, à internet, à la voiture et à tant d’autres aspects de mon quotidien, qui, de nature triviale et évidente, avaient passé le cap du superflu pour devenir insidieusement des besoins. Je n’étais pas prêt non plus à accueillir une famille de réfugiés en permanence sous mon toit. Tout au plus acceptais-je de renoncer aux voyages lointains, de m’engager pour la communauté à un niveau local, de soutenir des ONG et de me lancer dans des diatribes contre l’exonération fiscale, par exemple, du transport aérien mais, j’en étais conscient et le reconnaissais à contrecœur, autant par peur personnelle de l’avion que par conviction écologiste.
Et comme se plaisait à le souligner Merce, changer le monde ne me dispensait pas de sortir les poubelles, ranger la vaisselle, aller à la déchetterie, passer l’aspirateur et m’abstenir de laisser trainer mes chaussettes sales sous le lit au lieu de les mettre dans la corbeille à linge. Et, insistait-elle, il était non seulement permis mais recommandé par les médecins d’oublier parfois tous les malheurs du monde et lui faire l’amour aussi souvent que possible.
– Là, mon ami, je vois que nous avons un point commun : des compagnes avec les pieds bien sur terre qui nous sont devenues indispensables en nous prouvant que l’amour ne s’abreuve pas que de passion mais aussi d’une bonne dose de pragmatisme permettant de gérer les contingences matérielles de la vie quotidienne en commun.
– Oui, tu l’as dit ! En tous les cas Merce a un bon sens et un esprit pratique qui tempère ce que j’ai d’idéaliste et me permet de vivre bien au quotidien et pas seulement dans l’avenir. Et mon quotidien sans elle, j’aurais peine à l’imaginer ! Mais si tu permets, j’aimerais finir mon récit.
– Pas de problème, je t’écoute…
Marwan, lui, ne se prenait pas la tête : il allait être médecin, et, le temps d’une vie, il pensait contribuer à soulager les douleurs, à sauver la vie de ses frères humains, où qu’ils soient, tout en s’assurant un revenu qui lui permettait d’assurer un quotidien confortable ainsi qu’à sa future famille nombreuse qu’il pensait avoir un jour.
Bref, cette année passa sans que nous n’ayons pu prendre la mesure du temps et nous nous retrouvâmes à l’entrée de l’été, bac en poche et projets en tête.
Nous avions eu tout le temps de confirmer nos choix professionnels.
Xavier, passionné par la terre, la nature, les plantes et qui faisait preuve d’une grande habileté manuelle, avait interrompu ses études au collège du Sud à Bulle pour suivre un apprentissage de paysagiste. Il terminerait sa formation et aborderait la vie professionnelle en même temps que nous passerions le bac. Je le voyais au moins une fois par semaine, parfois plus, et tenais à cette amitié qui m’attachait aussi à notre village.
Marwan avait donc opté pour des études de médecine qu’il pensait poursuivre à Berne, histoire d’ajouter à ses compétences médicales, la maîtrise parfaite de l’allemand.
Merce, éprise de justice et tatillonne sur les bords, un large bord même lui faisais-je remarquer parfois, opta pour le droit dont la faculté de Fribourg passe pour l’une des meilleures du pays.
Quant à moi, je me décidai pour la Haute Ecole Pédagogique avec, en toile de fond, la possibilité de compléter ce diplôme de degré Bachelor me permettant d’enseigner au primaire, par un master me permettant d’accéder à l’enseignement secondaire. Tu vois, on arrive presque au moment où tu m’as connu, au début de ce stage.
– Ouais, c’est vrai. Et je te remercie pour ta confiance et ton amitié. Même quand tu auras terminé tes études et que tu ne seras plus un petit instit’ comme ton serviteur mais un professeur du secondaire, tu pourras, si l’envie ou le besoin t’en prend, toujours appeler au secours, demander des conseils ou bêtement partager un verre ou une excursion en montagne, si toutefois monsieur le professeur accepte de continuer à fréquenter la piétaille et le prolétariat de la pédagogie.
– J’apprécie, le papé ! Et je me rappellerai tes promesses mais j’espère plus pouvoir partager des moments de détente que de t’imposer mes confidences et les restes de mon enfance mal digérés.
Merce, éprise de justice et tatillonne sur les bords, un large bord même lui faisais-je remarquer parfois, opta pour le droit dont la faculté de Fribourg passe pour l’une des meilleures du pays.
Quant à moi, je me décidai pour la Haute Ecole Pédagogique avec, en toile de fond, la possibilité de compléter ce diplôme de degré Bachelor me permettant d’enseigner au primaire, par un master me permettant d’accéder à l’enseignement secondaire. Tu vois, on arrive presque au moment où tu m’as connu, au début de ce stage.
– Ouais, c’est vrai. Et je te remercie pour ta confiance et ton amitié. Même quand tu auras terminé tes études et que tu ne seras plus un petit instit’ comme ton serviteur mais un professeur du secondaire, tu pourras, si l’envie ou le besoin t’en prend, toujours appeler au secours, demander des conseils ou bêtement partager un verre ou une excursion en montagne, si toutefois monsieur le professeur accepte de continuer à fréquenter la piétaille et le prolétariat de la pédagogie.
– J’apprécie, le papé ! Et je me rappellerai tes promesses mais j’espère plus pouvoir partager des moments de détente que de t’imposer mes confidences et les restes de mon enfance mal digérés.
Commentaires (0)
Cette histoire ne comporte aucun commentaire.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire