Créé le: 10.09.2018
1725
0
0
Isidro chapitre 03/ Il y a longtemps, en Colombie
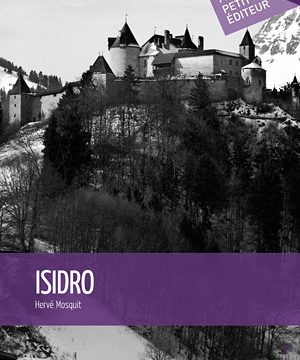
J'ai laissé passer jeudi passé, 6 septembre et c'est donc avec un peu de retard et un lundi que je vous livre le 3e chapitre de mon roman "*Isidro". Promis juré, pour la suite, je tenterai vraiment de m'en tenir au jeudi soir de chaque semaine.
Reprendre la lecture
Isidro chapitre 3
Colombie, région de Cartagena, même époque
Il était tard, passé minuit. Le village était tapi entre deux collines, à quelques dizaines de kilomètres de la côte atlantique de la Colombie. La lune était cachée. Il faisait nuit noire et, du haut de la colline qui surplombait le village, on apercevait quelques lumières, faibles et vacillantes, laissant deviner ce gros bourg peuplé au mieux de cinq à six mille âmes.
Au dehors, on entendait le bourdonnement incessant des insectes, les cris des singes ou ceux, plus rares, des rapaces nocturnes et, parfois, le bruit lointain des vagues. Le hamac recouvert d’une moustiquaire de fortune, se balançait, comme poussé par une main invisible. Bercé par le balancement régulier, Isidro, trois ans, dormait du sommeil du juste. La chaleur était moite, étouffante, à peine atténuée par un vent chaud venu de l’Atlantique, charriant des senteurs marines et les fragrances des plantes tropicales de la forêt toute proche. L’humidité collait à la peau, la rendant poisseuse et adhésive, un peu comme les mains sur lesquelles a jailli le jus d’un fruit trop mûr.
La maison en briques nues se composait de trois pièces de plain-pied : une grande pièce commune où dormaient les parents, une chambre pour le petit et une cuisine, dans laquelle se trouvait le seul accès à l’eau courante, froide, de la maison.
Les toilettes se trouvaient dans une cabane en bois au fond d’une cour en terre battue, derrière le petit bâtiment couvert de tôles qui abritait le vélo et le pick-up du père, une poussette, quelques jouets défraichis et un capharnaüm d’objets hétéroclites récupérés dans la décharge municipale.
Seule la rue principale du village était goudronnée. Les ruelles adjacentes, flanquées de maison semblables à celle de Luis et Inès, se contentaient d’un tapis de sable poussiéreux par temps sec et d’une gangue de boue quand tombaient les grosses pluies tropicales.
Le couple faisait l’amour, avec ardeur, douceur et passion, mais mesurant leurs gestes et réfrénant cette envie de crier leur plaisir pour ne pas réveiller leur fils Isidro.
Quand ils en eurent terminé, Inès s’assit, et regarda son homme étendu sur le dos, les mains sous la nuque. Elle le trouvait beau : de taille moyenne, musclé comme un athlète, Luis avait le teint café au lait et les cheveux crépus, témoins de ses ancêtres esclaves et conquistadores. Inès, avec ses grands yeux noirs, ses yeux bridés et ses cheveux de jais ne pouvait nier la prépondérance amérindienne de son ascendance. Jeune homme en quête de travail, son grand-père avait immigré du Pérou il y a de ça une quarantaine d’années. Elle demanda à son homme :
– Tu es sûr qu’on ne va pas avoir d’ennuis ? personne ne t’a vu ?
– Ne te préoccupe pas autant, ma colombe. Personne ne m’a vu. Tout le monde a remarqué quel entrain je mettais à couper et à récolter les feuilles que j’ai livrées cet après-midi à l’hacienda. Les hommes de monsieur Lopez m’ont remercié, ont tout pesé et payé comme d’habitude. C’était normal qu’après, j’aille jusqu’à la ville faire quelques courses avec la camionnette. Et je t’assure qu’il était impossible de voir les feuilles que j’avais glissées dans du plastic noir à l’intérieur des deux pneus de réserve. Et finalement, c’est notre terrain, ce sont nos feuilles et c’est mon travail que je vends.
– Oui, je sais et je suis d’accord. Mais tu sais aussi que le jour où le moustachu a accepté de nous acheter notre production, il nous a interdit d’en faire autre chose que de la lui livrer, sous peine de sanctions très graves. Et pour ces « cabrones », tu devines aussi bien que moi ce qu’ils entendent par sanctions très graves. Non ?
– Oui ma douce, mais avec ce que me paient chaque fois ces jeunes yanquis, nous aurons bientôt de quoi quitter la région et partir au Venezuela ou pourquoi pas même au Costa Rica ou à Trinidad et ouvrir une buvette à touristes. On partira de ce trou qui pue la mort, tu verras ! Isidrito aura une autre enfance que les nôtres. Il ira à l’école et surtout il y restera. Il fera peut-être même des études, tu ne crois pas ?
– J’ai quand même peur Luis…
– Arrête de te faire des idées noires. Viens vers moi, va !
– Non, attends Luis, je veux aller voir Isidro. Je veux vérifier si sa moustiquaire est bien en place. Je ne voudrais pas que ces sales bêtes le piquent encore comme la semaine dernière.
– Alors vas-y. Je sors fumer devant la maison.
Luis s’installa sur le porche en bois, sortit une cigarette, l’alluma et se mit à penser à tout ce qu’il pourrait faire, loin, très loin d’ici, avec le bénéfice qu’il engrangeait par la vente des feuilles de coca soustraite à la livraison obligatoire à monsieur Lopez et sa famille qui tenaient tout le village sous leur coupe depuis des années.
Luis ne se rappelait d’ailleurs pas avoir vécu sans que cette maudite famille fasse la pluie et le beau temps dans la région, jusque dans l’église dont ils avaient réussi à chasser l’ancien curé qui prêchait trop la justice sociale. Le pauvre avait eu un accident de voiture mortel le jour où il quittait le village pour sa nouvelle paroisse. Tout le monde disait qu’il devait être trop triste et avoir la tête ailleurs pour manquer ainsi ce virage et aller s’écraser dans le rio. D’autres murmuraient aussi que la tristesse avait bon dos et que le padre Joaquin était trop combattif et trop bon conducteur pour avoir provoqué lui-même cet accident. Luis partageait cette opinion mais ça ne changeait rien.
Depuis, la famille Lopez faisait venir un prêtre de la ville, choisi par eux, tous frais payés, pour les mariages, les baptêmes, les enterrements à l’occasion desquels ils offraient chaque fois une obole tarifée à leurs employés, entre un et cinq dollars américains selon le rôle que les gens tenaient dans les affaires de la famille. Même quand ils avaient tué l’oncle de Luis ou lors du décès accidentel de son père, écrasé par un tracteur dans les champs de coca, ils avaient donné 1 dollar à la famille pour payer l’enterrement.
Luis écrasa sa cigarette dans la boue et rentra.
Un pick-up tout terrain remontait péniblement la ruelle en terre battue qui séparait les deux rangées de maison du quartier. Arrivé devant la maison, il s’arrêta et trois hommes en sortirent.
Ils frappèrent à la porte.
– Luis, sors de là, on veut te parler !
– Qu’est-ce que vous voulez ? Ne criez pas, le petit dort.
– Tu sais que M. Lopez n’aime pas qu’on le vole ?
– Je n’ai jamais volé M. Lopez. Je lui ai livré toute ma production.
– Ah bon ? eh bien ce n’est pas ce que nous a dit le jeune yankee qui est reparti chez lui avec le bus du soir.
– Quel yankee ? je ne vois pas de quoi vous voulez parler .
– De ça, pauvre imbécile, regarde cette photo, si ce n’est pas toi qui discutes avec lui, je me demande bien qui c’est ?
– Ah oui, je me souviens. C’est le jeune touriste à qui j’ai indiqué la direction de l’hôtel Atlantico. Et comment vous avez eu cette photo ?
– Sa petite amie vous avait photographié, des fois que la transaction tournerait mal. Tu ne l’avais pas vu cette gringa. Elle n’était pourtant pas loin. Il a suffi qu’on les secoue un peu et qu’on menace ce type de s’occuper de sa chérie pour qu’il nous raconte tout et nous vide leurs sacs à dos avec une bonne partie de ta production !
– Vous devez vous tromper, je lui ai juste indiqué la direction…
– Tais-toi, tu connais le prix.
Luis se mit à courir. Il ne fit pas dix mètres. Les trois hommes ouvrirent le feu en même temps. Fauché par les rafales de M16 et d’AK47, Luis s’effondra au milieu de la ruelle boueuse. Les trois hommes ramassèrent son cadavre, le jetèrent sur le pont de la camionnette, prirent place et s’en allèrent.
Inès, sur le pas de porte, hurlait le nom de son bien-aimée.
Sitôt les assassins disparus, des lumières s’allumèrent et des voisins entourèrent Inès. La prenant tour à tour dans leurs bras, lui apportant à boire ainsi qu’au petit, réveillé par les détonations et les cris de sa mère. Les voisins murmuraient quelques mots de réconfort. Un vieil homme rejoignit l’attroupement. Les gens s’écartèrent. Il prit Inès dans ses bras, lui sécha ses larmes, la força à le regarder. Inès dit juste :
– Papa…
– Tu ne peux pas rester là ma fille. Va chercher ton fils. Je vous emmène à la ville. On va aller chercher de l’argent, tout ce qu’il me reste à la banque, et vous irez prendre le bateau pour le Panama. Si je pouvais te le payer, je te mettrai dans un avion pour l’Europe mais ta mère et moi n’en avons pas les moyens.
– Nous ça va, querida. J’ai ma retraite des chemins de fer. Ce n’est pas beaucoup mais ça suffit pour ta mère et moi et nous n’avons jamais eu à faire avec Lopez. Tes deux frères se débrouillent à Bogota avec leur taxi. Ton Luis n’avait plus de parents et plus personne de sa famille n’habite ici. Il te faut partir. Cet endroit sent la mort et n’offrira aucun avenir à ton fils. Va jusqu’à Panama. Après tu verras.
– Papa..
– Ne discute pas, va tout de suite préparer tes affaires. Je me chargerai d’Isidro.
Le vieil homme prit le petit dans ses bras et lui expliqua que son papa avait disparu et qu’il fallait partir le rechercher avec sa maman, très loin d’ici. Isidro acquiesça d’un hochement de tête puis replongea dans le sommeil lové au creux de l’épaule de son grand-père qui l’installa délicatement dans le pick-up de son beau-fils.
Une heure plus tard, le père d’Inès, au volant de la camionnette de Luis, atteignait les faubourgs de Cartagena. Isidro dormait dans les bras d’Inès. La jeune femme était dans un état second, abasourdie, choquée, anéantie par ce cauchemar. En quelques secondes, elle avait l’impression d’avoir tout perdu. Elle en voulait un peu à Luis. Mais comment lui reprocher d’avoir tenté de sortir sa famille de ce
bourbier ?! Il n’imaginait probablement pas le type de risques qu’il prenait. Ces gens-là étaient des salauds, des reptiles à sang froid pour qui ne comptaient que le profit et le pouvoir qu’ils avaient sur toute la région. Elle savait très bien que son père avait raison : ils seraient tôt ou tard revenus la harceler et lui prendre le peu qu’il lui restait ou même la violer impunément et la mettre sur le trottoir pour rembourser les prétendues dettes de son mari.
Partir était la solution mais que trouverait-elle là-bas ? L’angoisse face à ce voyage vers l’inconnu l’inquiétait cependant moins que la perspective de se retrouver en présence des assassins de son mari.
Son père avait tout arrangé. Il savait qu’il fallait faire vite. Il avait un ami d’enfance, pêcheur à Cartagena, qui avait accepté de prendre Inès et Isidro à bord et de les amener au Panama, jusqu’à Colon, près de l’entrée du canal sur la côte atlantique. De là, elle se débrouillerait pour gagner la côte Pacifique et Panama city, qui offrirait à la fois un meilleur anonymat et plus de possibilités de gagner quelques sous.
Le visage buriné par le soleil et les embruns, ridé au point qu’il faisait penser à une carte de géographie en relief, Esteban affichait un sourire lumineux quand il aperçut le père d’Inès, sa fille et son petit fils sur le quai. Il les rejoignit, donna l’accolade à son ami et fit immédiatement monter tout le monde sur le bateau. Il les entraîna dans la cabine où sifflait une bouilloire. Il servit du café aux adultes et versa
un verre de jus d’orange pour Isidro. Il connaissait la situation et il n’y avait pas grand’chose à ajouter. Le père d’Inès prit congé en tendant une liasse de billets au vieux pêcheur.
– Tiens Esteban, c’est pour ta peine.
– Tu vas me vexer amigo. Depuis quand paie-t-on l’amitié ? Un jour peut-être tu pourras aussi me sauver la vie ou celles des miens.
– Merci Esteban, je n’oublierai jamais et je serai toujours là pour toi si tu me le demandes.
– Je le sais. Mais maintenant, il faut que tu t’en ailles. L’aurore n’est pas loin et je dois partir au plus vite. Mes collègues vont bientôt arriver sur le port et je préfère que personne ne me voit partir et surtout, que personne ne vous voit sur mon bateau ou autour du port. Les Lopez ont des yeux et des oreilles partout. Tu as pris la bonne décision en me demandant d’évacuer ta fille et son petit. Surtout, tu as eu fin nez en me les amenant tout de suite. Demain il aurait peut-être été trop tard. Vaya con Dios, amigo !
– Hasta luego, Esteban, cuidate ( à bientôt, prends soin de toi ) et veille sur eux jusqu’au Panama !
Le père embrassa sa fille et son petit-fils et, les larmes aux yeux, sortit prestement du bateau. Il courut le long du quai jusqu’à la camionnette, se mit au volant et démarra. Pendant ce temps, Esteban avait mis le moteur en marche, largué les amarres et guidait son bateau vers la sortie du port. Il n’y avait encore âme qui vive sur le port et rien ni personne n’y bougeait quand ils atteignirent la haute mer.
Inès et Isidro s’étaient endormis dans les hamacs qu’Esteban avait installés au fond de la cabine.
Un seul homme d’équipage, un neveu en qui il avait toute confiance, l’accompagnait pour ce périple un peu particulier. D’habitude, le vieux pêcheur jetait ses filets dans une zone relativement proche des côtes. Parfois, il prenait des touristes, pour une journée de pêche ou emmenait des passagers, de jeunes routards pour la plupart, jusqu’au Panama ou au Venezuela. Il connaissait donc le chemin à suivre pour atteindre Colon. Le trajet, selon les conditions et avec un petit bateau comme celui-là, prendrait environ 25 heures alors que les Ferries modernes en mettaient la moitié.
Par chance la mer était assez calme. Le tangage et le roulis du petit bâtiment de pêche s’avéraient tout à fait supportables même pour qui n’avait pas le pied marin. La jeune femme et son enfant avaient besoin de récupérer et cette traversée leur permettrait d’accumuler des heures de sommeil. La lampée de rhum versée discrètement par Esteban dans leur thé, juste après avoir appareillé, contribuerait peut-être à ce que Morphée fasse son travail de la manière la plus efficace possible.
Le lendemain dans la matinée, ils atteignirent Colon et le vieil homme envoya son neveu avertir Inès et Isidro. Inès réveilla son fils, lui fit un brin de toilette et empoigna la valise contenant les quelques habits et effets personnels qu’elle avait rassemblés à la hâte avec son père, juste après le meurtre de Luis. Une bouffée d’émotions la submergea un instant. Elle avala un verre d’eau pour faire disparaitre la grosse boule d’angoisse qui se faisait insistante dans sa gorge et l’empêchait de parler normalement.
Esteban leur indiqua le chemin de la gare, le « terminal Atlantique », d’où ils pourraient emprunter le train qui relie la côte Atlantique à la ville de Panama sur l’océan Pacifique. Le vieil homme griffonna l’adresse d’un ami d’enfance qui devait travailler maintenant comme ouvrier d’entretien au golf de Panama. Il y ajouta un petit mot de recommandation, demandant, si nécessaire, de loger la jeune femme et son enfant, le temps qu’elle trouve un emploi et un logement. Puis il prit congé non sans avoir prodigué à Inès des conseils de prudence : ne pas donner son vrai nom de famille, ne pas se laisser aborder par n’importe qui, faire le maximum pour passer inaperçus et ne pas laisser Isidro évoquer à haute voix et en présence d’inconnus leur lieu de départ et les événements de la nuit passé.
Il y avait un train par jour qui quittait Colon à dix-sept heures quinze. Après avoir entamé le maigre pécule d’Inès dans l’achat des billets de train, de bouteilles d’eau et d’un peu de nourriture, ils passèrent le reste de la journée à proximité de la gare, tantôt se baladant, tantôt assis sur un banc.
Dès que cela fut autorisé, ils prirent place à bord du train. Le convoi s’ébranla avec à peine dix minutes de retard, emmenant la jeune mère et son fils vers l’inconnu.
Dans le train, le petit garçon meublait l’espace sonore de son babil continu, commentant tout ce qu’il apercevait à l’extérieur : la forêt, les animaux, les rares maisons, le canal que l’on apercevait parfois, les bateaux. Un couple d’étrangers semblait se délecter de ce discours enfantin et engagea la conversation avec Inès. La femme parla la première. Elle avait un accent qu‘ Ìnès n’avait jamais entendu : elle connaissait l’accent des anglophones par les touristes gringos qui passaient parfois dans le village en quête d’exotisme ou d’artisanat local. Le parler de sa voisine n’avait pas la même musique : cela ressemblait un peu à un langage d’enfant. Elle ne roulait pas les r mais semblait aller les chercher au fond de sa gorge : ils sonnaient un peu comme une version adoucie de la « jota » hispanique. Elle ne tarda pas à apprendre que la voyageuse était française.
Inès apprit ainsi que sa voisine et son mari étaient enseignants pour deux ans au lycée Paul Gauguin, le lycée de l’alliance française du Panama. Ils revenaient d’une excursion sur la côte Atlantique qu’ils n’avaient pas encore eu l’occasion de visiter depuis leur arrivée dans ce pays.
Elle ne comprenait pas très bien ce qu’était un lycée mais elle saisit tout de même qu’il devait s’agir d’une institution qui suivait l’école obligatoire, comme celles que fréquentaient, à Cartagena, les enfants des familles aisées de son village.
Elle inventa qu’elle avait perdu son travail de cuisinière à Colon, et dans la foulée son logement dont elle ne pouvait plus payer le loyer. Elle pensait pouvoir trouver plus aisément du travail et un logement dans la capitale.
L’homme jeta un coup d’œil à sa femme qui lui adressa un bref hochement de tête. Il s’adressa ensuite à Inès :
– Vous savez cuisiner ?
– Bien évidemment. Je suis veuve et je cuisinais pour mon mari et mon fils. Auparavant, j’aidais ma mère qui m’a tout appris.
– Et le ménage, les nettoyages, le service ?
– Vous savez, je cherche du travail. C’est une question de survie et je suis prête à m’adapter à tout. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions ? Vous connaissez peut-être des gens qui cherchent une employée de maison ?
– En fait, il s’agit de nous. Nous avions une employée de maison mais elle a du retourner au Costa Rica dans sa famille. Et comme nous travaillons tous les deux à plein temps, nous n’avons que peu de
temps pour ces tâches domestiques. Par contre, nous gagnons assez pour engager quelqu’un. Si ça vous intéresse, nous vous prenons à l’essai un mois puis nous vous ferons un contrat fixe si vous nous donnez satisfaction. Qu’en pensez-vous ?
– C’est inespéré et j’aurais tort de faire la fine bouche. Pour moi ça marche. Je commence quand ?
– Eh bien tout de suite si vous êtes d’accord. J’ai cru comprendre que vous alliez vous mettre à la recherche d’un logement. Venir chez nous résoudrait ce problème.
– Et Isidro ?
– Nous espérons beaucoup avoir des enfants un jour. Donc, nous aimons les enfants et sa présence ne pourra qu’apporter de la vie et bousculer un peu nos habitudes qui ne demandent qu’à l’être. Il y a une école dans le quartier : il n’ y aura aucun problème pour l’inscrire en maternelle.
– Je ne sais pas que dire ? J’ai l’impression de vivre un conte de fées. Et je ne sais même pas comment vous vous appelez.
– Oh désolé, j’aurais du commencer par là. Comme vous le savez, nous sommes enseignants au lycée
français de Panama. Je m’appelle Yannick de la Bretèque et je viens du Sud de la France. Mon épouse Mélanie est d’origine suisse.
– La Suisse, c’est ce pays au nord de l’Europe où il fait très froid ?
– Non, vous pensez à la Suède. La Suisse est un petit pays à côté de la France, au Sud de l’Allemagne, au nord de l’Italie et à l’Ouest de l’Autriche. On y parle quatre langues mais aussi le français. J’ai connu mon épouse en faisant des vacances dans les montagnes suisses. Elle terminait ses études de professeur de français et d’anglais. Après, elle est venue me rejoindre à Lyon, c’est une grande ville en France. Puis nous sommes venus ici.
– Et vous, vous enseignez quoi ?
– Moi ? j’enseigne la géographie et l’histoire.
– Il me semblait que vous deviez faire quelque chose comme ça : avec tous ces pays et ces villes dont vous me parlez et que je ne connais pas. En tout cas, je me réjouis et j’espère que vous serez contents de moi. Travailler pour deux professeurs, c’est aussi bien pour Isidro. Moi, j’ai juste fait 5 ans d’école primaire, et encore, je manquais souvent pour aider mes parents.
– Si vous restez chez nous, il va de soi que vous pouvez compter sur notre aide pour la scolarité de votre fils.
– Pour la scolarité, je préfère encore attendre un peu. Isidro est très jeune et j’aimerais bien le garder près de moi encore un moment. Pour le reste, je ne sais pas comment vous remercier…
– En nous donnant satisfaction : c’est tout simple !
Inès ferma les yeux, soupira et remercia Dieu, Pachamama, la providence ou bêtement la chance qui avaient mis ce couple sur son chemin. Elle s’assoupit, se laissant bercer par le mouvement régulier du train et le babil de son fils qui n’arrêtait pas, avec ses mots d’enfant et sa merveilleuse candeur, de commenter le paysage.
Commentaires (0)
Cette histoire ne comporte aucun commentaire.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire