Créé le: 23.08.2018
1765
0
0
Isidro chapitre 01/ Louis Pagès
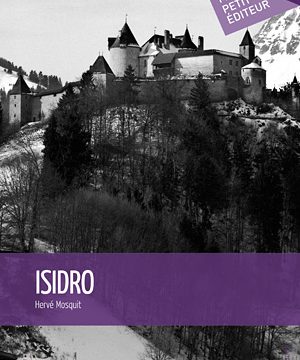
Du Panama au midi de la France, de Montpellier à la Gruyère , sans oublier un saut en Syrie, la vie d’isidro n’est pas banale… C’est mon 3 e roman publié et je vous l’offre en feuilleton…
Reprendre la lecture
Hervé Mosquit/ Isidro : chapitre 1
Je m’appelle Pagès, Louis Pagès. Oui, je sais ça en jette moins que Bond, James Bond et ça fait plus berger cévenol qu’agent secret. Cela dit, j’ai la prétention de croire que ce que j’ai à raconter
aura autant d’intérêt que les aventures de cet agent secret au service de sa majesté britannique.
J’ai grandi à flancs de coteaux , à l ’écart d’un village tapi au fond d’une vallée, le bien nommé St-André de Valborgne. Mon père, surnommé Polichinel, était maçon et ma mère touriste et institutrice. Je dis touriste car c’est en restaurant la maison de vacances de la famille Rime, des Suisses, que mon père a rencontré, séduit puis épousé ma mère. Epouser des touristes semble être un atavisme familial : en effet, mon grand-père paternel, bouquiniste à Paris, avait séduit une jeune cliente de 18 ans, qui s’aventurait pour la première fois dans la capitale en quête d’un travail de domestique. Il ne tarda pas à l’engrosser et à l’épouser. Etablis à Paris, ils quittèrent néanmoins assez rapidement la capitale, l’occupation allemande y étant probablement pour quelque chose. Le couple revint ainsi au village où la famille de ma grand-mère l’accueillit avec une relative froideur, ayant mal accepté que tout ce que leur fille put ramener de Paris fût un polichinelle dans le tiroir, d’où le surnom de mon papa.
Après douze ans de mariage, la distraction d’un grutier qui lâcha une benne de béton sur mon géniteur imposa un veuvage prématuré à ma mère. Cette dernière préféra rentrer au pays. C’est ainsi qu’à l’entrée de l’adolescence, je me retrouvai dans une région dont je trouvais parfaitement incongru et du plus haut comique qu’elle portât le nom d’un fromage. Il me fallut quelques mois pour comprendre que c’était le contraire. Dans la foulée et de surcroît, à ma grande déception, j’appris que le gruyère n’avait pas de trous. N’ayant guère de disposition pour la maçonnerie pas plus que pour de hautes études scientifiques ou littéraires, j’optai pour l’Ecole Normale avec, en toile de fond de ce choix, une admiration sans borne pour le grand Célestin Freinet.
Mais je ne suis pas là pour vous raconter ma vie. Je voulais vous conter l’histoire d’Isidro, jeune collègue devenu mon ami et celui de toute ma famille. Son parcours me semble assez emblématique des années qui s’étirent de la fin du siècle passé jusqu’à aujourd’hui.
Je commencerai, avant de reculer plus loin dans le passé, par vous conter ce qui a rempli un bel après-midi du mois d’octobre passé, en espérant ne pas trop alourdir, ou égayer, cela dépend de vous, mon propos par trop de digressions. Je suis, en ce domaine, un champion toutes catégories qui me vaut, dans le meilleur des cas, ce petit mot récurrent que mes proches utilisent à souhait: « Abrège ! ». Ils prétendent aussi parfois que je pète dans l’azur. Ce à quoi je réponds invariablement par ce proverbe de Papouasie orientale qui dit en substance :
« Mieux vaut péter dans l’azur et baiser dans la joie que de se retenir dans les deux cas ».
Pour vous, je n’abrégerai pas et nourris l’espoir ténu que vous ne considériez pas que je pète dans l’azur. Voici donc ce récit.
L’automne pointait le bout de ses colchiques et distribuait des couleurs à nos forêts, de la nostalgie à nos soirées, du spleen aux rombières, du temps aux agriculteurs, des soucis aux enseignants et des soupçons de frimas qui font se couvrir les bras et ranger les terrasses.
Il était environ quinze heures. Je sortis en claquant la porte, pas trop fort, mais juste assez pour signifier mon insatisfaction face à la colère offusquée et aux explications alambiquées de mon interlocuteur. D’habitude, l’ire des irascibles infatués, imbus d’eux-mêmes et de leur importance, irradie ma bonne humeur et déclenche inévitablement mon hilarité ironique. Mais cette fois, mon sens de l’humour et la distance respectable que j’entretiens à l’égard de toutes les contrariétés et vicissitudes de la vie quotidienne, s’étaient fait la malle à mon corps défendant. Autrement dit, j’étais grinche en sortant.
Une fois à l’extérieur, j’aspirais goulûment une grande bouffée d’air frais. Bénéfique pour l’oxygénation et salutaire pour l’humeur, ce réflexe le fut moins pour mon odorat. Le vent charriait en effet des effluves de purin, à peine atténuées par les senteurs provenant du massif de rosiers et de citronnelle qui bordait l’allée menant à la villa.
Je laissai donc derrière moi cette bâtisse à la décoration dispendieuse dont le mauvais goût culminait dans ces quelques lettres en métal doré gravées sur la façade : do mi si la do ré : quelques notes pour chanter la banalité du repli sur soi. Je me fis également la réflexion que les colonnades antiques et le toit provençal de cette construction au luxe ostentatoire s’intégraient aussi bien au paysage de nos Préalpes que ne l’eussent fait des meringues et de la crème dans une ratatouille. Je détournai les yeux vers le panorama qui s’offrait en contrebas. Les quelques pas nécessaires pour rejoindre ma voiture me laissèrent le temps de me remplir de ce paysage familier dont je ne me lassais pas et qui avait le don de m’apaiser.
Quelques brumes s’effilochaient sur le lac et la basse Gruyère, parsemant leurs filaments de Corbières à l’île d’ Ogoz. Au loin, les sommets du Moléson et de la Dent de Broc se partageaient quelques rayons résiduels d’un soleil peu généreux, tant à cette heure qu’à cette saison . Entre les deux, bien plus bas, on apercevait la silhouette de la ville et du château de Gruyères dressée comme une sentinelle à l’entrée de la vallée de l’Intyamon .
Avant de m’installer au volant, je savourais quelques instants le silence, ce silence savoureux quand ne s’entend que la douceur silencieuse du vent qui souffle mais qui devient suspect et assourdissant quand il suinte l’indifférence à la souffrance. En l’occurrence, cette fois, je ne m’étais pas tu. Je n’étais pas tombé dans le piège de l’indifférence.
Je n’allais pas laisser détruire mon jeune collègue Isidore par cette caricature de patriarche que je venais de quitter : héritier d’une grosse fortune familiale, notable plus craint que respecté, cet individu était affecté d’un égo aux dimensions à faire pâlir d’envie une Montgolfière et projetait sur sa progéniture ses rêves de gloire et de pouvoir. Père absent à la vie éparpillée entre les conseils d’administration, les voyages et les soûpers d’affaires, il n’intervenait dans l’éducation de ses enfants que pour accéder à tous leurs caprices pour autant qu’il s’agisse de dépenses de prestige : téléphones portables dernier cri, habits marqués, équipements sportifs et autres achats permettant de les distinguer du commun des mortels et de souligner leur appartenance sociale à ce que d’aucuns appelaient la bonne société. Il devait se prendre pour un comte de Gruyère contemporain ou tout au moins comme un membre influent de la cour. Quoique, réflexion faite, je me demandais même si , en cette époque lointaine, ledit comte ne portait pas à ses manants plus de considération et de respect que ce notable ne le faisait envers ses frères humains de condition modeste.
Mais à l’époque du comte de Gruyère, le vrai, il y avait le Chalamala, le fou du comte, dont le rôle était de rappeler quelques vérités à son suzerain et de le faire descendre de son piédestal, avec délicatesse et humour certes, mais vraisemblablement avec une certaine efficacité. Les fous du roi me plaisaient : je m’identifiais volontiers avec ce rôle essentiel qui est de préciser que le pouvoir se mérite et implique des responsabilités.
A notre époque aussi, il est souvent nécessaire de redire que la compétence n’est pas livrée en kit avec une élection, une nomination ou le hasard de la naissance. Au risque de passer pour un Alien débarqué de je ne sais où, je ne m’étais jamais privé de jouer le Chalamala de service ou l’ iconoclaste, que ce soit au service militaire ou dans ma vie professionnelle. Il suffisait de le faire avec humour et politesse pour éviter de donner prise à d’éventuelles représailles et surtout de savoir toujours poser au bon moment cette question essentielle : pourquoi ?
A première vue, mon interlocuteur n’avait guère apprécié la question posée par l’obscur instituteur que j’étais, de surcroit natif du Languedoc et naturalisé, il est vrai par des fonctionnaires assermentés et non par un taxidermiste, ce que que ce monsieur eût peut-être préféré.
Bref, ce respectable bourgeois avait beau être relativement frisé des circonvolutions cérébrales et afficher un QI qu’il aimait à montrer à tous les pensants, il n’imaginait pas pouvoir se tromper et s’accrochait à ses certitudes aussi fermement que le grimpeur au rocher. Je concède que le fait d’être borné comme une route nationale et avide de pouvoir n’est pas forcément l’apanage des bien nantis. L’incapacité à pratiquer l’empathie est une maladie intellectuellement transmissible qui peut affecter toutes les couches de la société même si, reconnaissons-le aussi, elle devient plus contagieuse en présence de comptes en banques bien garnis.
La raison de ma visite était fort simple : je voulais tenter de dissuader ce monsieur de maintenir la plainte pénale qu’il avait déposée contre le jeune professeur de classe de son fils. L’enseignant, mon jeune collègue Isidore, s’était rendu coupable d’une perte de contrôle en infligeant au précieux rejeton ce qu’il convient d’appeler une mandale, un soufflet, une tarte, bref une bête gifle partie en réaction à un coup de pied dans les tibias asséné par cet adolescent . Il faut dire que ce petit morveux de quinze ans, au demeurant un élève relativement brillant, bâti comme une armoire à glace, boutonneux comme une calculette et colérique comme un taureau en fin de corrida, avait piqué une crise de nerfs et proféré des menaces et des injures racistes à l’égard d’un camarade de classe. Ce dernier avait en effet eu l’outrecuidance de mieux réussir deux examens de mathématiques et d’anglais, alors même que sa couleur de peau et son passeport capverdien le prédestinait à ne bien réussir que la gymnastique voire éventuellement à jouer, dans les autres matières scolaires, les seconds rôles et le faire-valoir des enfants bien nés et du crû.
Rodrigo, c’était son nom, avait eu l’audace de s’en vanter sur ce réseau social prisé de ses congénères et pourvoyeur de quantités d’amis virtuels, ce qui constituait assurément aux yeux de son condisciple argenté et malchanceux, un crime de lèse-majesté , d’où la colère initiale du précieux rejeton.
L’enseignant avait exigé du calme et des excuses . Le gamin réagit à ces remontrances par un coup de pied sur un tibia professoral que l’on aurait pu imaginer muni d’un interrupteur tant la baffe s’envola en retour, au quart de tour.
La plainte immédiate du père auprès des autorités scolaires n’ayant aboutie qu’à une petite mise en garde formelle qui peinait à masquer une compréhension, ô combien justifiée, du jeune professeur, le père, insatisfait de cette apparente clémence, déposa aussitôt une plainte pénale auprès des autorités judiciaires pour abus d’autorité, coups et blessures. J’avais tenté de lui expliquer l’ineptie d’une telle plainte : Cette réaction immédiate à la douleur, certes inadéquate pour un professeur, ne constituait pas un abus d’autorité. De même, difficile d’admettre qu’une joue à peine rougie ne se définissait comme une blessure, à moins que l’amour-propre ne fasse partie de l’anatomie et n’ait son siège à la surface de ce petit coussin adipeux et acnéïque.
Le bonhomme n’avait rien voulu entendre. Cela me contrariait mais on n’allait pas pas en faire un fromage. Ce n’était que partie remise et je ne perdais pas espoir, même si, malgré tous mes efforts sophrologiques, une grosse colère se tenait encore et malgré tout en embuscade à la périphérie de ma conscience.
Je bouclai ma ceinture, mis le contact et démarrai. J’avais, pour me calmer et dissiper mon irritation, le temps du trajet. Si cela ne suffisait pas, je pouvais compter sur mon épouse. Elle représentait le plus beau cadeau que m’avait fait la vie.
Après plus d’un quart de siècle de vie commune, ce savant mélange de passion, de complicité, de respect, d’humour et de partage des joies comme des soucis, restait intact et tout comme le vin des côteaux de nos enfances respectives, s’était même bonifié avec le temps. Elle savait mieux que quiconque écouter mes indignations, reformuler mes révoltes, relativiser mes grandes envolées contre l’injustice, rire de mes excès verbaux, gommer mes doutes et doper ma rage de vivre à coups de sourires complices et de tendresse. Nos enfants, bien sûr, raillaient cet agglomérat de granit et de romantisme démodé dans lequel était taillé notre couple.
Je piaffais déjà d’impatience de lui narrer mon entretien. Mais avant, il me fallait encore passer voir Isidore et lui annoncer l’échec provisoire de ma démarche tout en tentant de le rassurer et de le requinquer. J’accélérai quelque peu.
Je n’avais guère le temps de musarder mais n’allais pas pour autant écraser le champignon. Je me faisais un point d’honneur à respecter scrupuleusement les règles de la circulation, estimant que ce n’était pas un domaine où la transgression des règles établies pût avoir une quelconque justification morale. J’abhorrais les chauffards, ces prédateurs du bitume qui compensaient dans ces prises de risques criminelles et dans la vitesse, ce qui immanquablement devait leur faire défaut dans la tête et les caleçons.
Pour moi, la voiture constituait avant tout un moyen pratique de déplacement dans lequel je n’aurais jamais eu idée de mettre ne serait-ce une qu’once de prestige, de fierté et encore moins de virilité, laissant à mon épouse l’usage exclusif et positif de ma testostérone. Mon véhicule constituait aussi une bulle, un igloo, un petit vaisseau spatial personnel dans lequel je pouvais sans déranger personne, chanter, me curer le nez, roter et péter sans retenue. Je ne nourrissais aucune honte à m’abandonner à ces manifestations physiologiques triviales et soulageantes, en me disant qu’il existait en ce bas monde, des émanations autrement plus malodorantes. Par exemple, et pour n’en citer que quelques unes, il y avait :
– Les flatulences xénophobes nauséabondes qui font de la peur de l’étranger un fond de commerce politique en faisant oublier que l’on pouvait être un bon citoyen quelles que soient notre origine, notre couleur de peau, nos croyances et surtout sans souscrire à ce délire haineux.
– Les vesses en rafales que lâchent parfois les chatouilleux de la gachette pour asphyxier la population en prétendant qu’un meilleur controle des armes qui protégerait nos familles contre de possibles drames, allait rogner la liberté du citoyen.
– Les pets religieux au goût de croisade et de jihad des intégristes et fanatiques de tous poils qui troquent le Dieu d’amour des grandes religions monothéistes contre un sectarisme borné, dévastateur et assassin.
– Les prouts pointus des pseudos élites qui pensent détenir l’exclusivité du bon goût culturel, de la bonne gouvernance, de la bonne éducation et jugent leurs prochains à l’aune unique de leur petite lorgnette personnelle.
Le temps d’évoquer ces incommodantes senteurs, sans oublier toutefois de maîtriser ma conduite automobile, j’avais atteint la localité où résidait mon jeune collègue.
En m’approchant du domicile d’Isidore, je me rappelai notre première rencontre lors de son dernier stage en classe primaire avant qu’il ne poursuive des études destinées à tenter, sinon de faire aimer, du moins d’inculquer à de jeunes ados des rudiments de littérature, d’histoire et d’anglais.
Isidro, en français Isidore, métis originaire d’Amérique du Sud, avait été recueilli par un couple franco-suisse. Devenue prématurément veuve, sa maman l’avait adopté puis avait vécu un moment dans la famille de son défunt mari, en France, avant de rentrer au pays avec son fils Isidro, dont on francisait le prénom en Isidore selon les circonstances et les envies de chacun.
Nous partagions, à une génération d’intervalle, une enfance dans le midi et une adolescence en Gruyère, ce petit coin de Suisse et du canton de Fribourg, aux confins des Alpes et du Plateau. Mon origine méridionale et mon âge avaient fait que très vite, il me surnomma le papé.
Ce jour-là, il venait de débarquer dans ma classe, après l’école, frais émoulu d’un parcours académique , bientôt muni des diplômes idoines, armé de quelques doutes et de beaucoup de savoirs, le visage poupin auréolé de jeunesse conquérante mais le regard sévère, conscient de sa propre valeur et des enjeux incommensurables qui allaient découler de sa carrière pédagogique naissante. Il avait demandé au vieil instit’ que j’étais:
– Au fond, pour toi, le papé, c’est quoi un enseignement de qualité ?
J’avais alors pris mon souffle et, retrouvant l’accent de mon enfance tant le sujet me passionnait, je lui débitai ce plaidoyer :
« Pécaïre ! Tu me poses là, mon nenou, une question à laquelle même le mistral et la tramontane qui voyagent pourtant beaucoup, auraient moult peine à répondre. Le concept même de qualité est on ne peut plus volatile et subjectif. Autant demander aux cigales de mettre en portées leur musique ou de disserter sur le sexe des anges, la psychologie des santons ou la sexualité des fourmis rouges en Patagonie occidentale.
Cependant, je veux bien essayer d’apporter une esquisse de réponse, même si je suis bien incapable, comme certains prétendent le faire, de te pondre sur l’heure un traité, vingt directives et trois échelles d’évaluation sur le sujet, le tout avec la bouche en anus de gallinacé et l’air triomphant que confèrent les les grandes certitudes.
Disons d’abord que chaque corporation professionnelle, dont la nôtre aussi malheureusement, crée et développe un langage qui lui est propre dont l’incompréhension par les profanes lui donne une résonance dithyrambique et n’a pour seule utilité que de s’entre-gloser , de fournir un alibi scientifique à ladite profession et d’affliger de l’inévitable complexe de supériorité celles et ceux qui la pratiquent. Discourir de cette manière te donnera peut-être la crainte qu’inspirent aux autres l’autorité des infatués mais aussi, sache-le, l’air pincé et ridicule des constipés du sourire. Et cela ne t’aidera aucunement à accompagner tes galopins, prompts à la galéjade, dans une gratifiante et bénéfique promenade à travers l’année scolaire.
Les mots pourtant seront tes amis mais choisis-les pour chacun de tes interlocuteurs : petits mots rigolos, mots moyens du quotidien, gros mots mais pas trop, peu importe ! L’essentiel est qu’ils fassent mouche : qu’ils apprennent, parlent au cœur, encouragent, exigent, consolent, fassent rire. Les autres, ceux qui blessent, qui prétendent, qui méprisent, qui abaissent, qui aboient, chasse-les sans pitié et sans permis ! Braconne–les et donne-les à dévorer aux féroces créatures de l’oubli nécessaire.
Tu seras harcelé de questions, mitraillé de remarques, abreuvé de directives, couvert de protestations parentales, étouffé de réformes et submergé de méthodes toutes aussi prometteuses les unes que les autres. Tu évolueras parfois dans un environnement villageois où le bon sens terrien et la solidarité villageoise côtoient les querelles de clans et le conservatisme étriqué ou dans un milieu urbain à la vie culturelle trépidante mais gangréné aussi par l’exclusion et le communautarisme. Tu affronteras
celles et ceux qui se prévalent du droit à la vérité unique en matière de pédagogie, de politique, de religion et j’en passe sans compter quelques hommes politiques fossoyeurs de l’éducation, obsédés par le moins d’impôts et les coupes budgétaires…
Devras-tu en souffrir ? Que nenni mon ami !
Pour survivre dans les flatulences malveillantes qui empesteront ton métier, il te faudra relativiser ces attaques. Imagines-en, par exemple, les auteurs à poil, les miches à l’air, la bistouquette au vent, les rotoplos balançant dans le sirocco ou les nibards dans le blizzard, perdus dans le désert ou sur la banquise et pleurant allo maman bobo. Et surtout ne souffle mot à quiconque du sort que tu imagines pour ces pisse-vinaigres. Cette image n’est là que pour te faire du bien.
Suis ton chemin tout en sachant travailler en équipe. Contente-toi d’être et de rendre curieux, de partager avec tes collègues tes trouvailles et tes doutes. Grappille et grignote toutes les théories mais sans jamais en prendre une seule pour du pain béni car, contrairement à ce que pourraient affirmer tes élèves, une doctrine n’est pas l’épouse du docteur mais peut effectivement être une maladie grave. Cultive ton enthousiasme, ta joie et ton bon sens sans lesquels rien n’est possible. Ecoute et accompagne tes élèves dans leurs questions. Exige d’eux le respect d’eux-mêmes et des autres. Fais-les rire et fais tout pour que la balade scolaire de ces enfants que l’on te confie se poursuive avec un maximum de bonheur en bandoulière.
Là, mon nenou, tu auras atteint l’essentiel qui t’apportera du plaisir à enseigner, t’évitera
d’être un enseignant triste au risque de devenir un triste enseignant et surtout, te donnera l’espoir, ténu mais solide, de faire peut-être de ces poupiots, de ces pitchounettes, de futurs citoyens responsables et solidaires. »
En sortant de mon véhicule, je me fis la réflexion que mes conseils visant à relativiser les attaques de tous les inévitables fâcheux qu’un enseignant pouvait croiser ne s‘étaient pas avérés très efficaces. Isidore allait mal. Il frisait même la dépression. Avec cet humour lourdingue qui me caractérise parfois, je me dis en passant que je n’imaginais pas la figure de la dépression avec des cheveux lisses. J’avais d’ailleurs tenté de changer les idées de mon jeune collègue en l’abreuvant de tous les contrepets rabelaisiens et des jeux de mots faciles que mes compétences mnésiques du moment me faisaient retrouver : « femme folle à la messe », « salut Fred », « déjà les roses sont affaissées et le petit veau ne verra jamais l’hiver » « particules et parties face », « alléluya …qui est Luya ? », j’en passe et des moins bonnes. Je lui rappelai les mots du directeur de l’école, lors de son entrée en fonction, qui avait commencé son discours, d’un ton théâtral et sans omettre les liaisons, par ces mots :« Bienvenue Isidore. Au cours actuel, les Isidores ont de la chance… » . Isidore en avait ri aux larmes y ajoutant des plaisanteries, parfois douteuses, sur le cours des bourses et autres allusions graveleuses par leur double sens. Il s’était promis de s’en faire une devise à ressortir les jours de blues et de à ressortir les jours de blues et de découragement.
Je lui avais rappelé cette promesse mais en vain. Face à son abattement, J’avais même ressorti toute ma panoplie de gags éculés qui marchaient encore avec de nouvelles personnes mais dont le ressort comique était détendu pour mes proches, la date de péremption étant largement dépassée. Mais rien n’y fit. Isidore était demeuré silencieux et prostré. J’appréhendais donc d’autant plus de lui faire le compte-rendu de ma tentative de conciliation.
Je sonnai. Sa compagne, Merce, m’ouvrit et m’informa qu’il était descendu en ville quérir les conseils d’un avocat. Presque soulagé de n’avoir pas à lui parler, je résumai très brièvement ma démarche et dis que je l’appellerai dans la soirée.
Je repris la route, quelque peu soulagé tout de même de n’avoir du affronter la tristesse de mon ami. Je me réjouissais également de disposer d’un laps de temps supplémentaire pour parler avec mon épouse avant de ressortir pour me rendre à l’assemblée communale prévue ce soir à vingt heures. Depuis ma naturalisation , je me faisais un point d’honneur à n’en manquer aucune, même si l’esprit de clocher se plaisait parfois à hanter ces démonstrations vivantes de la démocratie directe.
Mon passage à la maison me combla au-delà de toute attente. Le retour de nos enfants ne devant se faire que tard dans la soirée, nous profitâmes de ce moment pour échanger à bâtons rompus les résumés et les émotions de notre journée respective tout en éclusant force cafés. Etait-ce un effet de la caféine ou tout simplement la douceur particulière de cette soirée d’automne, le fait est que nous
finîmes la conversation avec plus de soupirs que de mots, sur le tapis du salon puis dans le lit conjugal dont j’émergeai juste à temps, la mine échevelée, chiffonnée et béate, pour sauter dans mes habits et rejoindre aussitôt l’assemblée.
A mon retour, mon épouse m’informa d’un appel téléphonique d’Isidore. Il était inutile de rappeler ce soir mais, avait-il précisé, il avait envoyé un courriel pour éviter que je ne me morfonde et m’impatiente en attendant d’avoir de ses nouvelles.
Fébrile, je me précipitai sur ma tablette numérique. Ce que j’y lus me remplit de joie :
« Salut Louis, salut le Papé,
Je sais que tu te démènes pour ma défense et que je peux compter sur ton soutien, ton indéfectible amitié et ton obstination à la Don Quichotte pour traquer et pourfendre les injustices. Mon épouse m’a mis au courant de ta dernière démarche et je t’en suis gré. Je sais aussi le souci qu’ont du te causer ma face de carême et mon comportement taciturne de ces derniers jours.
Mais rassure-toi, je crois que je vois le bout du tunnel et te promets que d’ici peu, nous pourrons à nouveau refaire le monde en éclusant quelques gorgeons et nous laisser aller à ces parties de rire débridées et sans équivoque qui font tellement de bien.
En effet, en sortant de l’étude de l’avocat que j’avais contacté, qui soit dit en passant, ne m’a laissé que peu d’espoirs de fléchir ce père quérulent, j’ai rencontré une amie d’enfance qui sans le vouloir tenait la solution à mon problème. En effet, après que je lui eus expliqué ce qui m’arrivait, elle m’informa aussitôt qu’elle venait de mettre un terme à une liaison avec ce même individu. Ce grand défenseur de la famille chrétienne, qui a ses habitudes chez les intégristes, s’octroyait une entorse secrète à ses convictions et trompait allégrement sa femme avec mon amie d’enfance. Cette dernière s’était bercée d’illusion quant à une possible vie commune. La fortune se trouvant essentiellement chez madame, il était exclu pour ce personnage d’envisager un divorce, extrêmement coûteux, sans compter l’atteinte à l’image d’homme intègre qu’il se donnait. Lassée, mon amie avait rompu.
Son ex-amant avait cependant oublié chez elle une montre de luxe, cadeau de son épouse. Il venait de la lui réclamer en exigeant que cela se fasse avec la plus grande discrétion. Mon amie d’enfance, Gwendoline de son prénom, m’a proposé d’elle-même et en riant, d’informer ce monsieur qu’il avait le choix entre le retrait de la plainte à mon égard assorti du retour discret de la montre ou d’une restitution de l’objet par le biais d’une visite de l’ex-maîtresse à l’épouse. Gwendoline vient de l’appeler et de m’informer illico qu’il avait
accepté . Il recevra sa montre, de manière discrète, dès que la plainte sera retirée.
Je me réjouis de te revoir. Merci encore pour tout. A bientôt.
Bien amicalement, Isidore. »
Je souris : plus de soucis à me faire pour ce méchant caillou déposé dans les chaussures de vie de mon ami : il avait disparu, s’était envolé, désintégré. Sur le fond, rien n’avait été résolu et j’eusse préféré que cette lutte contre la bêtise et la méchanceté jouisse d’une victoire un rien plus flamboyante que ce rapport de forces s’apparentant, si peu, à du chantage. Mais enfin, aux bons maux les bons remèdes et comme nous vivions dans un pays ne disposant pas d’un littoral marin, il semblait dans l’ordre des choses que souvent les problèmes se réglassent ainsi, sans faire de vagues…
Et voilà. Il était temps de retrouver mes draps douillets, les bras de mon épouse et ceux de Morphée qui allaient derechef me combler d’un égal bonheur.
Tout ça pour ça, me direz-vous. Nous sommes, il est vrai, loin du récit d’aventures qui entretient le suspense, allume les émotions et titille l’angoisse. Cela dit, rien ne vous empêche d’imaginer à cette historiette qui couvre à peine une journée, une chute, une suite de péripéties épiques, voire dramatiques qui déclencheraient cette fois les bruits de la passion, le vacarme des vagues et de la tempête.
Mais ne vous donnez donc pas cette peine. Le récit qui va suivre comblera cette lacune. Vous comprendrez, en découvrant ce qu’a vécu Isidro depuis son enfance, pourquoi je tiens tellement à ce que la vie de mon jeune collègue soit , dans la mesure du possible, exempte de drames, de soucis et demeure la plus heureuse possible.
En effet, dans son histoire, les bruits n’ont pas manqué : ressac de l’océan, cris d’animaux, détonations, hurlements de peur, de douleurs, insultes, moqueries mais aussi rires en cascade et rares cris de joie. Tout ce vacarme aurait pu ne pas le laisser intact mais il a réussi à surmonter ses souvenirs traumatisants et ses déracinements successifs pour devenir ce qu’il est. Surtout, il m’a fait l’insigne honneur de se raconter.
Comme j’adore raconter les histoires et que mes enfants en ont passé l’âge, c’est avec vous et dans ces pages que je vais prendre ce plaisir .
Tout a commencé, pour moi, il y a de ça quatre ans…
Commentaires (0)
Cette histoire ne comporte aucun commentaire.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire